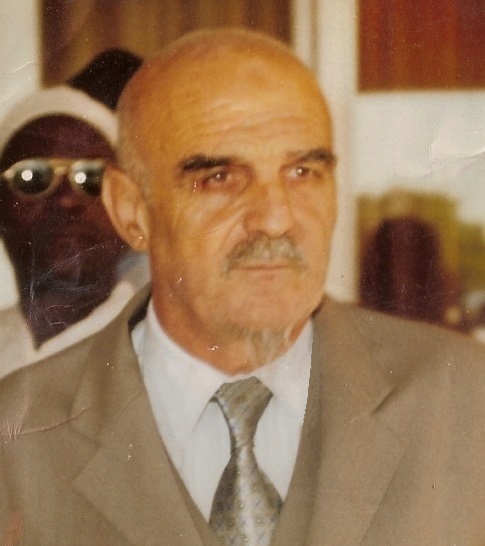
Ces discussions ont été entamées bien avant que ne se révèle l’intensité du drame. «Nous avons modifié si profondément notre environnement », écrivait ainsi Norbert Wiener, dès 1954, « que nous devons nous modifier nous-mêmes ». Vision utopiste ? Elle a en tout cas attiré l’œil d’un certain nombre d’investisseurs qui ont su y voir, au-delà d’une fuite en avant, de nouvelles opportunités de profit. Ainsi naquit le transhumanisme. Issu de la Silicon Valley (1), ce courant culturel n’ambitionne rien de moins que dépasser entièrement la condition humaine, pour accéder à un « nouveau stade de l’évolution » – la posthumanité – dont « l’homme » définirait cette fois lui-même les règles et non plus la Nature, enfin totalement « dominée ». Robotique et biotechnologie sans limites, puces d’identification et de surveillance implantées in corpore, voit-on l’enfer que sous-tend plus ou moins consciemment ce projet ? Mais aussi puissant soit-il en ce monde gangréné par l’argent, il ne manque pas – grâce à Dieu ! – de contradicteurs dans les plus hautes instances des élites mondiales.
Dans quelle mesure ceux-ci ont-ils compris qu’à s’abstenir de nous modifier nous-mêmes, il nous faut impérativement transformer le système qui nous gouverne ? La hantise du chaos les incite en tout cas, c’est très louable, à mettre en avant des solutions graduelles, évitant toute révolution exagérément radicale, mais celles-ci n’auront aucune chance de perdurer, si elles ne s’accompagnent pas d’une révision réellement complète du système, impliquant l’établissement – rétablissement ? (2) – de relations constantes et suivies entre le plus global et le plus local. La décongestion des centres de décision : décentralisation, déconcentration des institutions de l’État, etc. ; et, surtout, le développement massif de la Société civile vont en ce sens sans parvenir cependant à emporter la décision des masses populaires à s’organiser volontairement, chacun en son domicile et environnement quotidien, au service du bien commun. Abruties d’informations futiles, téléphones portables aidant, elles perçoivent d’autant moins l’urgence de s’y réunir qu’elles manquent d’espaces et de moyens pour y parvenir.
Une gestion, enfin, de la proximité ?
On a vu, en Mauritanie (3), l’incapacité de l’État à faire respecter son décret interdisant, en 2012, l’usage des sacs en matière plastique. Plutôt que déplorer la faiblesse des institutions à suivre l’application des lois, on s’emploiera plutôt ici à contester l’approche répressive d’une telle nécessité qui demande, avant tout, l’adhésion des populations. La question est donc ailleurs, plus précisément dans leur éducation, d’une part, et, d’autre part, leur capacité à gérer elles-mêmes leur environnement immédiat. Sur le premier point, on attend une révision approfondie des programmes scolaires intégrant, à tous les niveaux, une formation théorique et surtout pratique aux réalités environnementales, via des actions sur le terrain régulièrement suivies (4) ; et la généralisation de contrats entre le ministère de l’Éducation nationale et des associations à but non-lucratif visant à permettre l’organisation, hors temps scolaires, de formations pour adultes dans les établissements d’enseignement. Quant au second point, j’avancerai ici la promotion d’un des plus dynamiques outils traditionnels de l’Islam – le waqf – au service de la cohésion sociétale.
Ainsi que le rappelait madame Randi Deguilhem, directrice de recherches au CNRS, dans la préface d’un de mes premiers ouvrages (5), « […] assurément, le waqf est un outil qui lie et relie en réseau différents secteurs de la société, à des fins plurielles adaptées aux besoins changeants des époques. À bien des égards, la société musulmane [lui] doit les assises de son organisation religieuse, pieuse, sociale et parfois politique […] ». Le principe consiste à mettre à la disposition d’une personne physique ou morale – plus largement : une œuvre sociale déterminée – les bénéfices de la gestion d’un bien dont la propriété est immobilisée à jamais par son propriétaire légal, ainsi que tous ses rajouts éventuels. En l’occurrence de notre présent propos, il s’agirait de « doter chaque groupement localisé de quarante à quatre-vingt foyers, d’une organisation autonome et solidaire de leurs trivialités communautaires quotidiennes, financée par une Activité Génératrice de Revenus Communautaires (AGRC), gérée par un conseil d’administration tripartite, regroupant le propriétaire d’un foncier mis en waqf (État, collectivité locale, coopérative, particulier…), le bailleur de fonds équipant ce foncier et la solidarité locale appelée à profiter des bénéfices nets générés par cette activité » (6). (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Avant d’essaimer sur tous les continents, notamment en Asie – Zhongguancun (Chine), Bangalore (Inde), etc. – et en Afrique : Sémé City (Bénin), Silicon Savannah (Kenya), etc.
(2) : La question n’est pas vaine : présumant que ce dialogue fut naturellement entretenu dans les premières sociétés des hommes, elle situe tout l’intérêt à considérer avec attention les sources traditionnelles, essentiellement religieuses, qui les organisèrent.
(5) : « LE WAQF, outil de développement durable, LA MAURITANIE, fécondité d’une différence manifeste », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2012 ; 2ème édition 2025.
(6) : Voir mon ouvrage « D’ICI À LÀ », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2025, p 118.



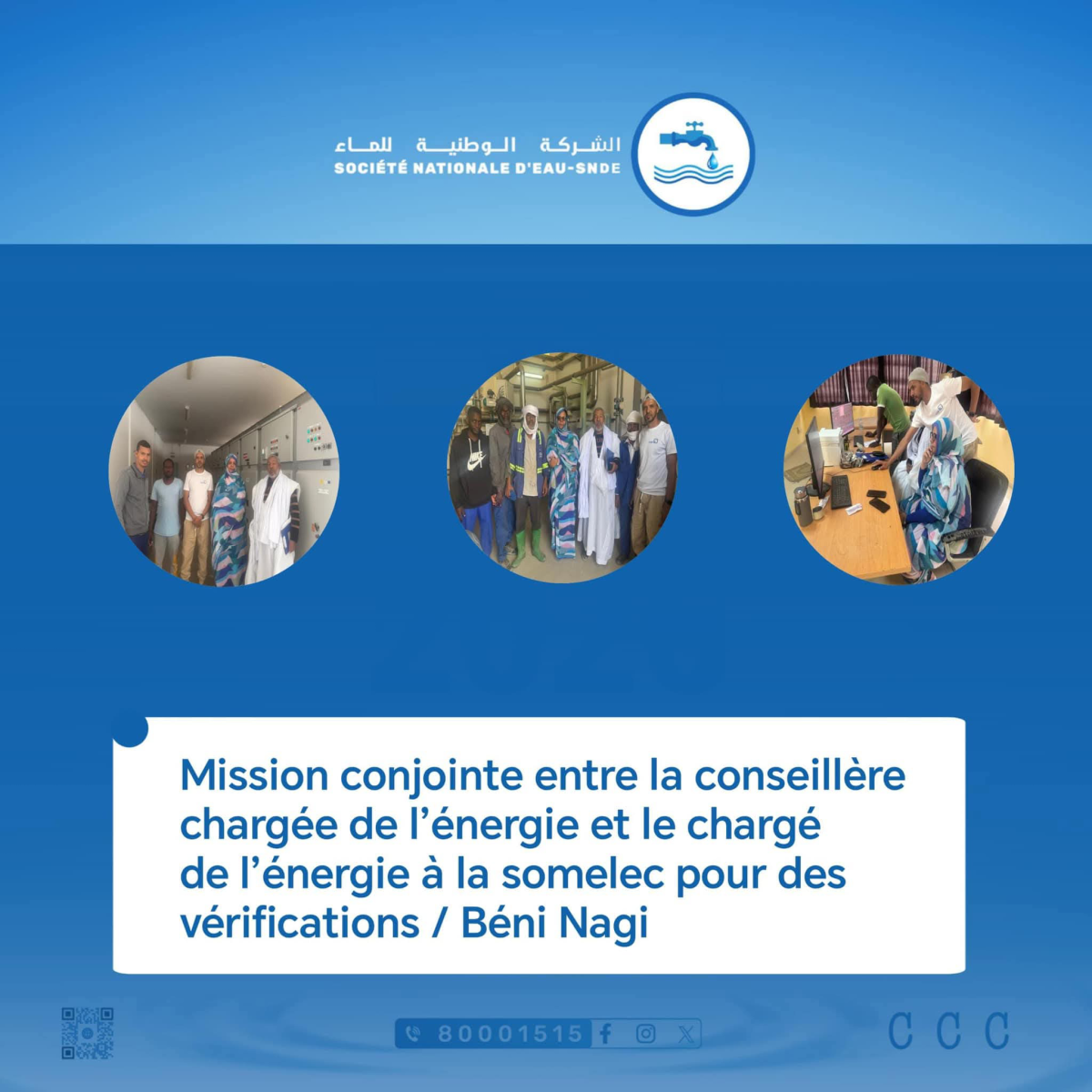

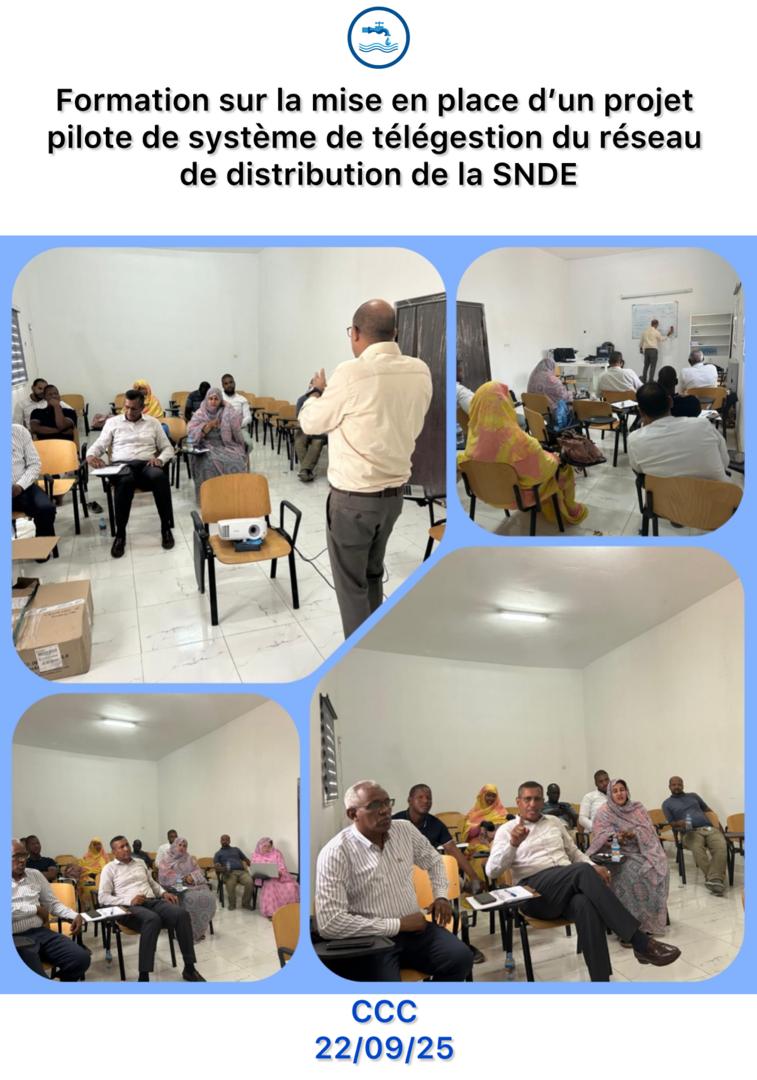
.gif)








.gif)