
Je viens d’achever la lecture de l’ouvrage de M. Abdi Ould Horma, ‘’De l’espérance à la désillusion : Chronique d’un État empêché – Mémoires d’un haut fonctionnaire mauritanien (1986-2023) " et à son propos, je me permets de partager quelques impressions critiques.
Dès les premières lignes de La Chronique d’un État empêché, on perçoit que l’auteur ne cherche pas à faire de politique politicienne.
Ses jugements, souvent brefs et alignés comme des notes de synthèse, rappellent l’écriture destinée à des décideurs pressés et peu enclins aux grands discours. Cette concision a un revers : les causes profondes de «l’empêchement » sont parfois esquissées puis rapidement évacuées, laissant le lecteur sur sa faim lorsqu’il s’agit de démêler l’enchevêtrement des responsabilités historiques, économiques et sociales. Mais c’est aussi ce qui confère à l’ouvrage son ton particulier : une lucidité froide, débarrassée d’idéologie, qui invite à la réflexion plutôt qu’à la polémique.
Dans cette optique, M. Abdi Ould Horma aligne des jugements sincères mais discutables.
Ce commis de l’État, qui a servi sous plusieurs présidents, ne cache pas son appréciation parfois sévère des différents régimes, mais il s’efforce de relativiser ses propos en mettant également en évidence leurs réalisations. Sa lecture de l’ère Ould Taya, par exemple, frappe par sa sévérité analytique : il souligne les blocages et les dérives de ce long règne, tout en reconnaissant, avec une honnêteté à saluer, les réalisations et la stature de l’ancien président, qu’il dresse finalement sous un portrait nuancé et même flatteur.
La même objectivité s’applique aux présidents Ely Ould Mohamed Vall (transition 2005- 2006 ), Sidi Ould Cheikh Abdellahi (tentative d'une gouvernance civile apaisée), Mohamed Ould Abdel Aziz (diplomatie offensive et assumée ) et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani (stratégie d'apaisement politique et avancées sociales réelles). Pour chacun, l’auteur relève méthodiquement forces et faiblesses, sans complaisance mais sans malveillance.
Toujours est-il que M. Abdi Ould Horma apparaît, à travers cette chronique, comme un acteur incontournable de l’histoire administrative mauritanienne. Son regard d’administrateur se retrouve dans son traitement du régime de transition de 2005-2007, période durant laquelle il a servi comme membre du gouvernement et, précisément, secrétaire d’État chargé de l’état-civil – une fonction ministérielle qu’il qualifie d’«inédite ». L’expression peut surprendre, car l’état-civil, en tant que département ministériel, existait déjà sous le régime précédent.
Néanmoins, le livre révèle un fait indéniable : M. Abdi Ould Horma peut être considéré comme l’un des véritables initiateurs – sinon l’initiateur – de la réforme de l’état-civil.
Un sens du détail
Pour l’histoire, cette réforme amorcée à la fin des années 1990 a pris une allure révolutionnaire en 2001 avec l’introduction de la carte d’identité infalsifiable, innovation qui a profondément transformé le paysage politique en permettant notamment à l’opposition de casser les reins du PRDS dans les quartiers populaires de Nouakchott et dans des villes comme Nouadhibou et Zouerate.
L’auteur décrit les étapes de cette innovation structurante avec un sens du détail impressionnant, offrant au lecteur une véritable archive de la construction de l’état-civil mauritanien moderne.
Sur le thème central de la décentralisation, l’auteur, spécialiste reconnu du sujet, soutient – avec raison – que l’un des grands empêchements de l’État mauritanien réside dans l’échec du développement local, conséquence directe d’une centralisation excessive qui a multiplié les blocages.
Dans la foulée de ses constats lucides, il éclaire aussi ce qu’il appelle «la dérive foncière », c’est-à-dire la gestion défaillante du territoire, notamment à Nouakchott et à Nouadhibou. La ceinture verte abandonnée de la capitale ou la plage de Nouadhibou, à la vocation touristique réprimée, deviennent pour lui des symboles de notre tendance à créer nos propres empêchements.
En somme, l’identité, la décentralisation et la participation citoyenne forment les trois piliers d’une conception de l’État que M. Abdi Ould Horma érige en doctrine. Il a su les défendre tout en observant un strict devoir de réserve – ce machin que certains décideurs invoquent paradoxalement pour bloquer les réformes.
Dans un système où nombre de ministres confondent la gestion des affaires publiques avec celle de leurs foyers, les fonctionnaires se retrouvent souvent « domestiqués », ou du moins soumis à une véritable domination qui étouffe créativité et esprit d’initiative. Leur statut et leur situation financière les exposent ainsi à une réelle précarité.
Une anecdote savoureuse illustre ce constat : un cadre de la SNIM, sollicité pour être détaché au projet de l’état-civil, exigea un traitement avantageux dont les fonctionnaires ne pouvaient rêver.
Sur ce point, je donne, de mon point de vue personnel, entièrement raison au cadre en question car pour produire des résultats, il faut, au-delà de la compétence et de l’engagement, une motivation financière à la hauteur des responsabilités.
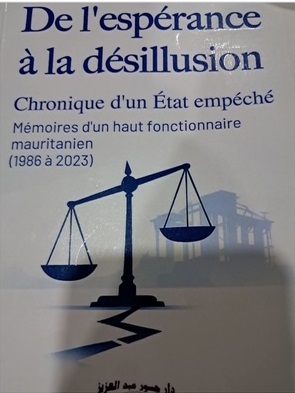
Conclusions un peu hâtives
Au total, la grande force du livre tient à sa valeur de témoignage d’un praticien qui a vu l’État de l’intérieur et a participé à d’importantes réformes dans des contextes différents. Il offre au lecteur une archive précieuse pour comprendre l’histoire institutionnelle mauritanienne récente, une mémoire que peu d’acteurs publics prennent le temps de consigner.
La limite principale réside, à mon avis, dans l’analyse causale : en voulant rester concis et « objectif », l’auteur n’explore pas toujours les racines profondes de la paralysie étatique – économiques, tribales, géopolitiques – qui mériteraient un débat plus nourri. Il se trouve parfois prisonnier de conclusions un peu hâtives, par exemple lorsqu’il évoque les couches défavorisées en citant dans la même catégorie jeunes, femmes et Haratines. À cette erreur d’ordre typologique s’ajoutent d’autres coquilles qui devraient être corrigées dans une prochaine édition.
Dans cette perspective, il conviendrait de soumettre l’ouvrage – qui ferait un excellent rapport de deux cents pages, un véritable « rapport Abdi Horma » – à un comité de lecture.
Ces remarques de forme ne diminuent en rien la qualité de ce livre-alerte pour l’avenir et qui se lit comme un appel à regarder sans complaisance l’État mauritanien : ses promesses, ses réussites, mais aussi ses blocages structurels.
À l’horizon 2035 et dans la perspective des prochaines échéances électorales, M. Abdi Ould Horma invite à une meilleure gouvernance, qui passe forcément par un regard lucide sur les blocages institutionnels, les inégalités sociales et les crispations identitaires, les dossiers sensibles tout en orientant son plaidoyer vers des propositions utiles à la classe politique et aux décideurs.
Qu’on partage ou non ses conclusions, on sort de cette lecture convaincu qu’il a livré un témoignage sincère, utile et indispensable pour quiconque s’intéresse à l’histoire et à l’avenir de l'Etat mauritanien.
Enfin, je termine sur une note d’optimisme. Au regard des avancées enregistrées dans des domaines vitaux – renforcement sécuritaire de l’armée, modernisation de l’état-civil, amélioration progressive de l’organisation des élections pluralistes, électrification des villes, énergie, agriculture, etc. – les empêchements évoqués ne me paraissent pas perpétuels.
De ce point de vue, je considère que le livre d’Abdi Horma, De l’espérance à la désillusion, peut être qualifié de chronique d’un État temporairement empêché.
Abdel Kader ould Mohamed



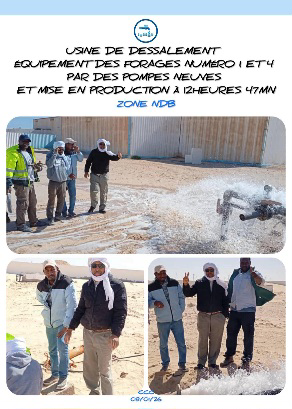

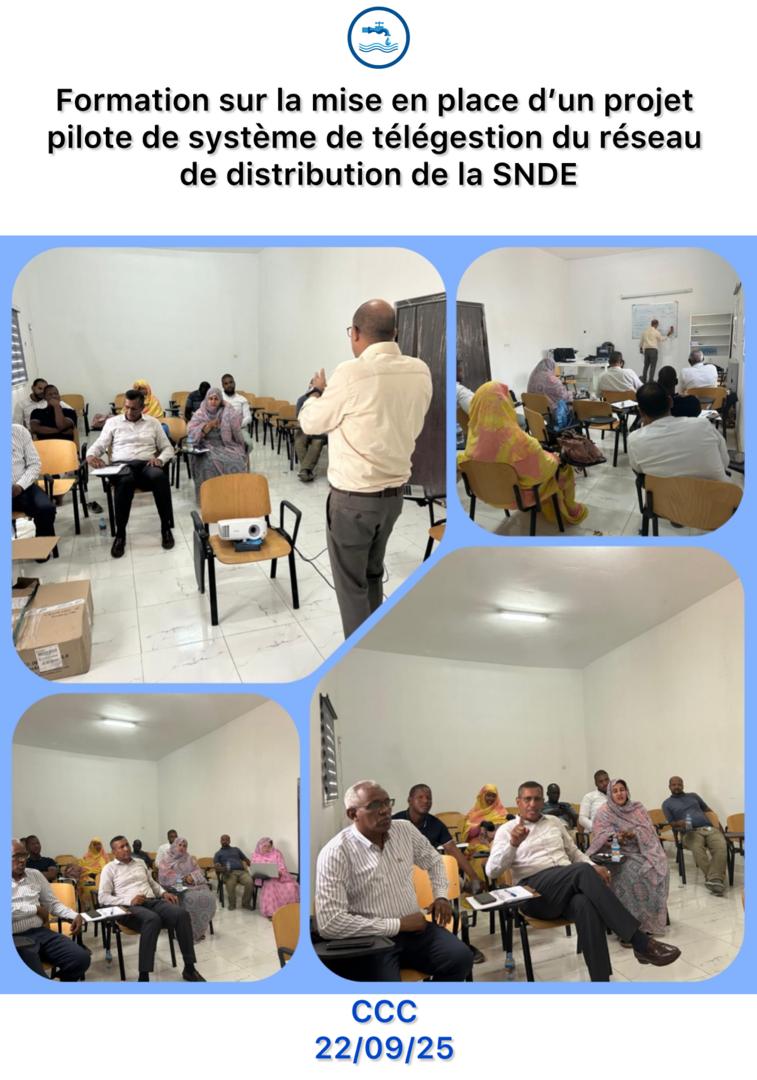
.gif)








.gif)