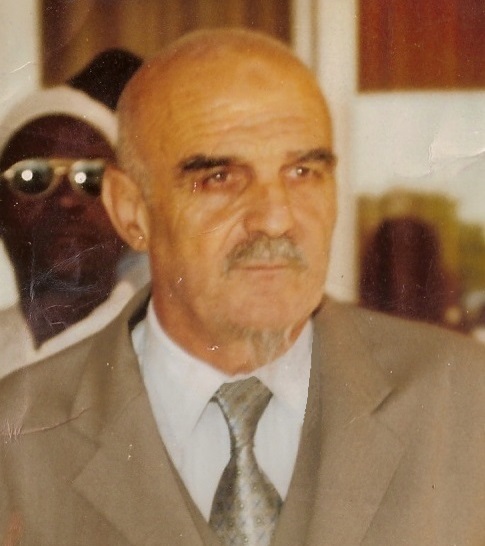
Dans quelle mesure ces nouvelles structurations sociales sont-elles liées à l’arrivée des Européens le long des côtes atlantiques de l’Afrique de l’Ouest ? Il faut, pour tenter de répondre à cette question, revenir un peu en arrière. L’installation des Portugais sur l’île d’Arguin, dans les années 1440, est limitée, en raison de l’aridité du sol et du manque d’eau potable. Attestés, les premiers échanges commerciaux avec les Maures sont réduits : esclaves et or contre céréales, tissus et fusils, essentiellement mais en faible quantité. Il faut attendre un bon siècle avant de voir apparaître, sur le continent africain, l’impact de l’ouverture des océans et de la multiplication des comptoirs européens le long des côtes ; notamment autour de l’embouchure du fleuve Sénégal que se disputent les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français qui fondent la ville de Saint-Louis en 1659. C’est dans ce contexte qu’apparaissent les mouvements djihadistes sahéliens qui vont profondément influencer les relations statutaires locales.
Probablement le premier de ceux-ci à cette époque dans la sous-région, le mouvement zawaya est particulièrement significatif de leur stratégie commune : extension territoriale, relations commerciales avec les Européens initialement limitées, excluant toute vente d’esclaves (1), utilisation préférentielle de ceux-ci à des fins d’extraction minière et de production agricole ou de transformations primaires de celle-ci (gomme arabique, par exemple), afin de former des États assez puissants pour résister à la pénétration occidentale ; et réorientation du commerce transsaharien vers l’Est, via la Libye et l’Égypte. La volonté du chef des zawayas, Nasr al-Dîne, un lettré très réputé pour sa piété et la simplicité de ses mœurs, de former une entité politique sans distinction ethnique, inquiète les tribus hassanes. Celles-ci trouvent des appuis circonstanciés avec les français de Saint-Louis, pressés par leurs croissants besoins en esclaves et qui leur fournissent préférentiellement des armes lors de la guerre de Char Bebbe (1644-1674) qui a éclaté entre les deux parties. On connaît la suite pour l’organisation sociale du pays maure…
De djihads sincères en djihads manipulés
Lancée au Fouta Toro, un siècle plus tard, par Thierno Souleymane Baal, un lettré peul tout aussi pieux et frugal que son prédécesseur Nasr al-Dîne, la révolution toorodo diffère, à son origine, du mouvement zawaya en ce qu’elle entend carrément mettre fin au régime des castes et abolir ainsi toute forme de servitude. Assassiné alors qu’il se reposait sous un arbre, au cours du conflit qui l’opposait aux tribus hassanes qui razziaient périodiquement la rive droite du fleuve Sénégal, Thierno Souleymane n’assista pas à l’élection de son disciple Abdoul Kader Kane au titre de premier Almamy par une assemblée conséquente d’oulémas (2), ni à la première ascension, au sein des Torodo, de bas castés instruits de l’islam. Un mouvement assez rapidement étouffé, suite à la progressive reprise en main du pouvoir par les Jagoordo, chefs de cinq des plus grandes familles traditionnelles du Fouta, qui finissent par assassiner Abdoul Kader Kane, vingt-neuf ans après le début de la révolution, sans parvenir cependant à éliminer le processus de coopération ethnique qu’avait propulsé celle-ci, notamment entre peuls et soninkés, ainsi que s’y employait, avec succès, l’imamat du Fouta Djalon depuis 1725.
Toutes les autres entreprises djihadistes en Afrique de l’Ouest, au long des 18ème et 19ème siècles, se distinguent par leur recours banal au « djihad de l’épée (3) », non seulement à l’encontre des populations animistes, mais, aussi, de musulmans jugés déviants par leurs conquérants. C’est notamment le cas des menées d’El Hajj ‘Omar Tall à l’encontre de l’empire du Macina dont les leaders en avaient fait de même à Djenné, en dépit du rappel du cheikh al-Bakkay, chef spirituel de leur tariqa (la Qaridiya), à toujours respecter les principes de tolérance et de paix prônée par celle-ci. En vain, apparemment, puisque c’est encore la rivalité entre les membres de celle-ci et ceux de la Tijaniya, dont El Hajj ‘Omar Tall se déclare le représentant, que se développe le conflit au Mali. Non pas, bien évidemment, qu’on veuille ici suggérer que tous les mouvements djihadistes de ces siècles agités, en Afrique de l’Ouest, aient été motivés par de plus ou moins vulgaires intérêts économiques. Loin de là, comme en témoignent l’éloquente frugalité des mœurs de leur fondateur respectif et l’enthousiasme désintéressé de leurs disciples. Même si une telle hypothèse ne peut être totalement écartée, elle doit être insérée dans une perspective beaucoup plus vaste. (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Un principe, le temps passant, parfois négligé, notamment au Fouta Djalon…
(2) Une démarche résolument démocratique, à l’instar de ce qu’avait établi, dès 1743, le premier État djihadiste peul fondé, plus au Sud, sur les hauts plateaux du Fouta Djalon.
(3) : Dernière option du djihad – « en cas d’extrême nécessité », précisaient les oulémas soufis de l’époque – après celui du « cœur », prêchant silencieusement par l’exemple et un effort personnel de purification, et celui de la « bouche », enseignant la bonne parole et les ‘oussouls de l’islam.



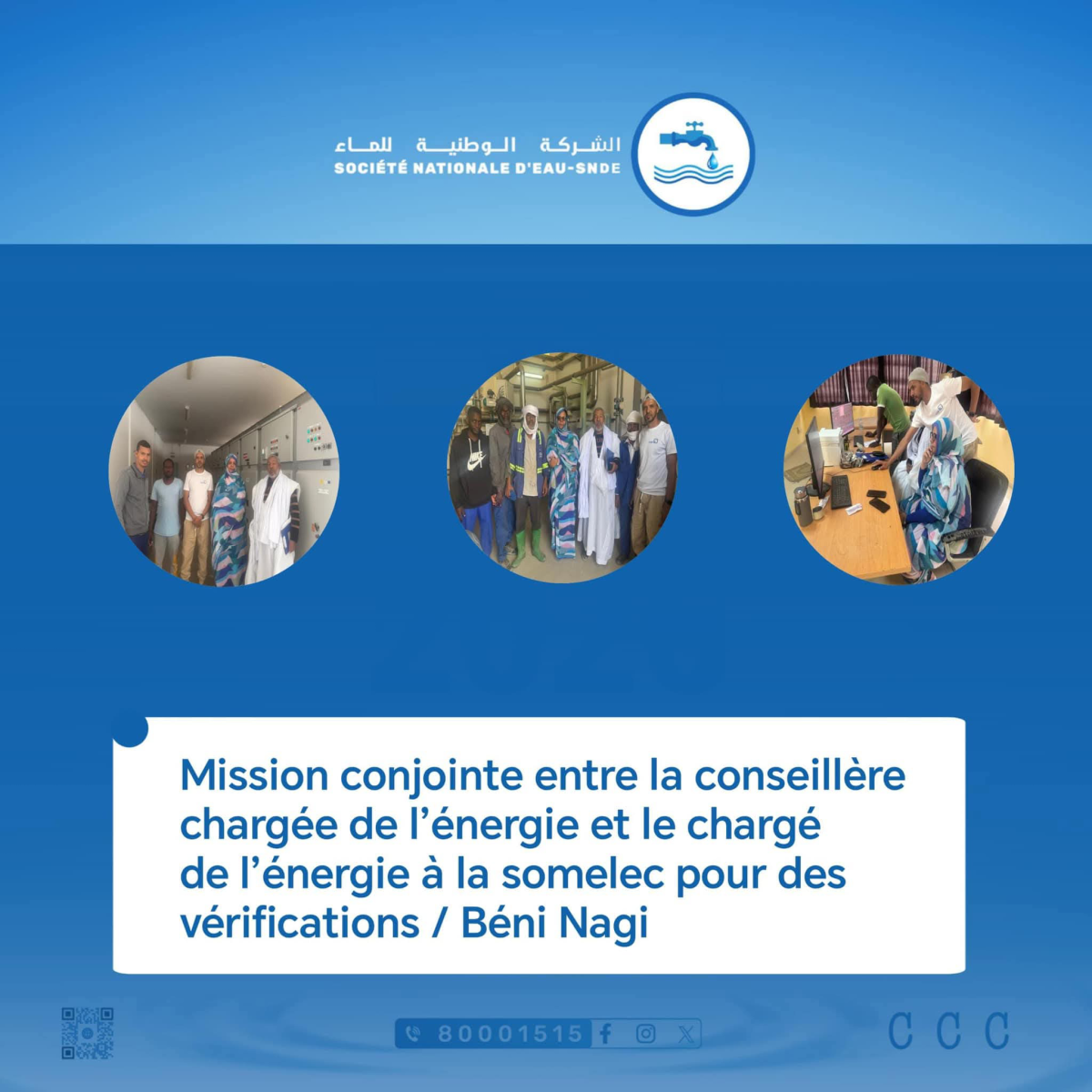

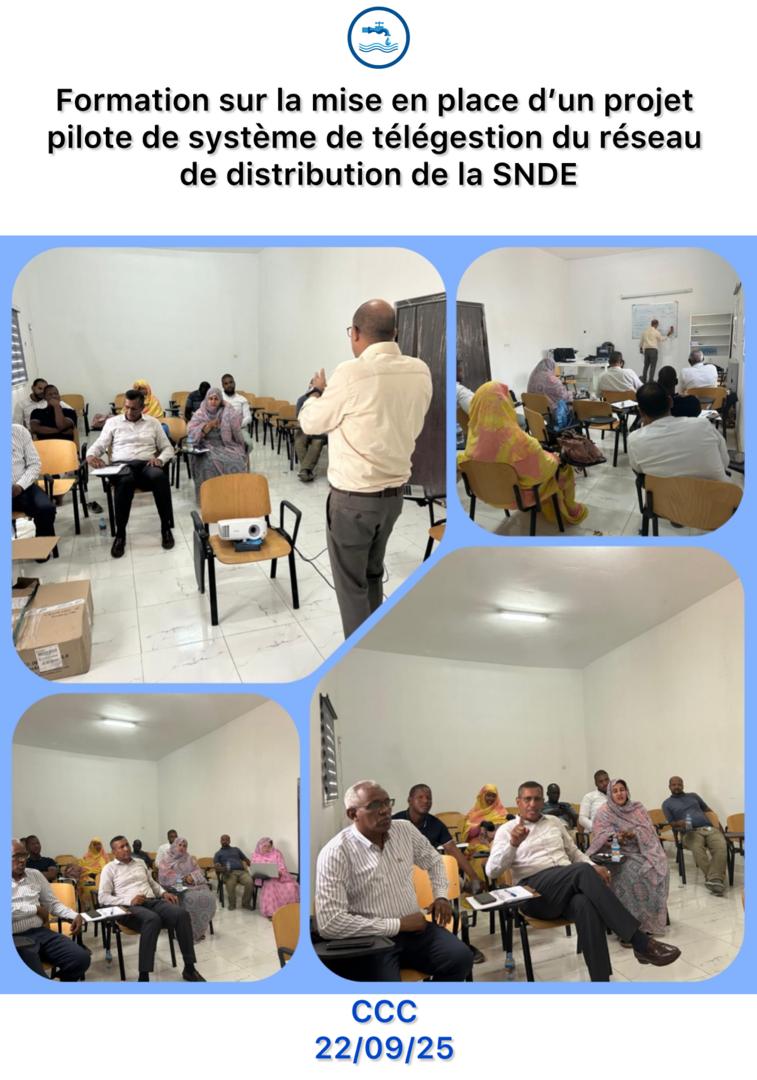
.gif)








.gif)