
Derrière les images d’un président au contact des plus modestes se profile une opération politique soigneusement calculée. En s’affichant auprès des populations haratines dans les régions les plus reculées, Mohamed Ould Ghazouani cherche-t-il à réaffirmer une proximité sincère ou à reproduire, sous une forme plus subtile, les codes d’un paternalisme ancien ? Entre stratégie de communication et lutte symbolique contre Biram Dah Abeid, cette mise en scène soulève de vives interrogations sur la manière dont le pouvoir aborde la question, toujours brûlante, de l’héritage esclavagiste en Mauritanie.
Les images récemment diffusées, montrant le président en immersion au sein de populations haratines dans les zones les plus reculées du pays, disent long sur un populisme outrancier, empreint à la fois de mépris social et de désenchantement politique.
Nous comprenons désormais le véritable objectif du président Mohamed Ould Ghazouani lorsqu’il a ordonné à ses ministres de passer leurs vacances à l’intérieur du pays : mener une opération de mystification auprès des populations haratines, afin de raviver une forme de conformisme et de subordination néo-esclavagistes de plus en plus effacée dans les centres urbains et certaines localités.
À supposer que le président agisse de bonne foi, mû par une réelle compassion envers les victimes de l’esclavage, de la privation, de l’abandon et de l’exclusion, force est de constater qu’il a été mal conseillé — et qu’il s’y est pris avec maladresse, tant sur le fond que sur le plan médiatique, lui comme ses ministres.
Certes, ces images immortaliseront le souvenir d’une modestie affichée, d’une simplicité calculée, d’une familiarité soigneusement entretenue et d’une tendresse inédite que le président a su mettre en scène. Toutefois, si elles peuvent encore flatter les esprits aliénés par l’héritage de l’esclavage ou servir de levier aux complexés de tous bords, elles apparaissent, aux yeux de tout citoyen lucide en 2025, comme profondément anachroniques, contraires à l’esprit du temps et, pour la conscience haratine, comme une provocation teintée d’hypocrisie — quelle que soit la sincérité des sentiments affichés de part et d’autre.
Ces images s’avèrent d’ailleurs foncièrement contre-productives, tant la gêne palpable et la timidité visible des protagonistes trahissent le malaise d’une mise en scène aux relents néo-esclavagistes, aussi embarrassante que mal inspirée.
Calculs à courte vue
Le président, malgré son insistance à exhiber ses affections prétendument familiales, peine à se départir de son impassibilité coutumière, n’esquissant qu’un sourire visiblement contraint.
Quant à ses Haratines — car c’est bien ainsi qu’il faut les percevoir dans ce cadre pesant de reproduction symbolique —, ils semblent endurer, dans un silence résigné, le poids d’une condescendance théâtralisée, d’un paternalisme populiste et outrancier, vidé de toute dignité partagée.
Sur la forme, l’initiative présidentielle semble s’être retournée contre lui, tant elle résonne comme un acte désespéré, un aveu implicite d’une culpabilité historique, la reconnaissance d’une responsabilité morale longtemps éludée, et, plus gravement encore, comme un manquement au devoir présidentiel.
Sur le fond, en s’affichant parmi les plus démunis, le président semble avoir voulu opposer une image « populaire » à celle, élitiste et théâtrale, de la tournée féodalo-bourgeoise de Biram Dah Abeid en Adrar et en Inchiri.
Mais à l’image de ce dernier, le président semble lui aussi mal appréhender la profondeur de la question de l’esclavage, n’ayant manifestement tiré que peu de leçons de son évolution récente. Chercher à l’aborder uniquement à travers le prisme du phénomène Biram ou à l’instrumentaliser dans le cadre de rivalités politiciennes conjoncturelles, c’est naviguer à vue et réduire une problématique existentielle pour l’avenir de la Mauritanie à des calculs à courte vue.
C’est d’ailleurs précisément ce type de manœuvres politiciennes, choquantes et révélatrices de la résilience d’un conservatisme esclavagiste profondément enraciné, qui nourrissent l’utopie d’un Biram se rêvant déjà en sauveur providentiel des Haratines et de la nation tout entière.
Son obsession pour la présidence de la République alimente aujourd’hui une scène politique marquée par des jeux d’alliances contre nature, souvent parmi les plus sordides. D’un côté, tout semble permis pour tenter de le contrecarrer ; de l’autre, lui-même s’emploie à ratisser large parmi les mécontents du système qu’il combat — exclus du régime Ghazouani pour une raison ou une autre.
Il convient ici de rappeler que les parcours de Mohamed Ould Abdel Aziz, Ahmed Ould Daddah et Messaoud Ould Boulkheir restent des expériences vivantes, suffisamment éloquentes pour avertir ceux qui s’engagent aujourd’hui sur une voie erronée. Car la Mauritanie ne sortira ni de son impasse politique, ni de l’héritage tenace de l’esclavagisme, en s’en remettant à des régimes minés par la mauvaise gouvernance ou à des figures d’opposition prisonnières de leur narcissisme, de leur individualisme exacerbé et d’un égoïsme sans mesure.
Espérons, pour le salut de la Mauritanie, que le dialogue annoncé puisse enfin voir le jour, qu’il permette de sortir de ce jeu de dupes, et qu’il ouvre, enfin, la voie vers un avenir plus juste et plus prometteur.
Mohamed Daoud Imigine
18 Août 2025



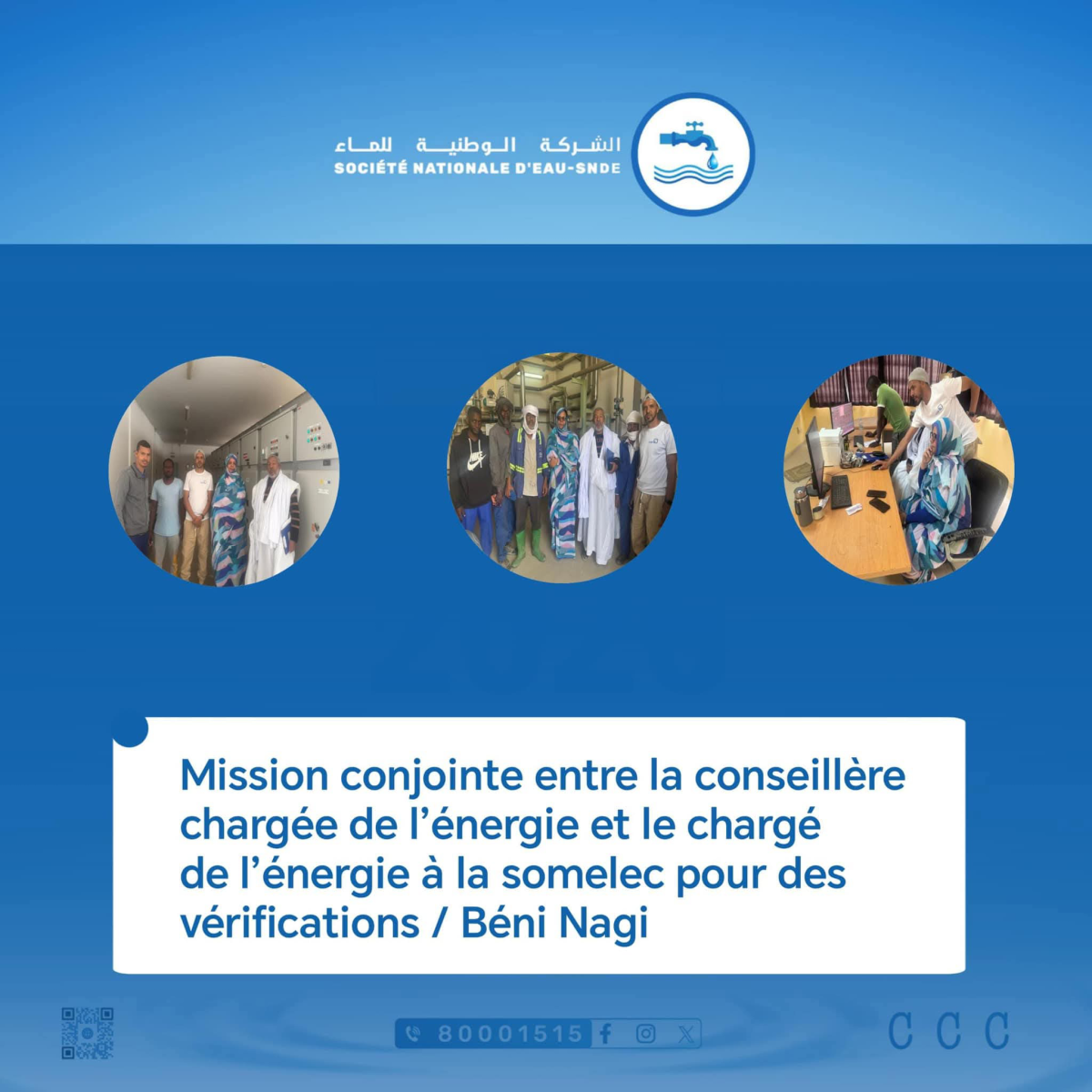

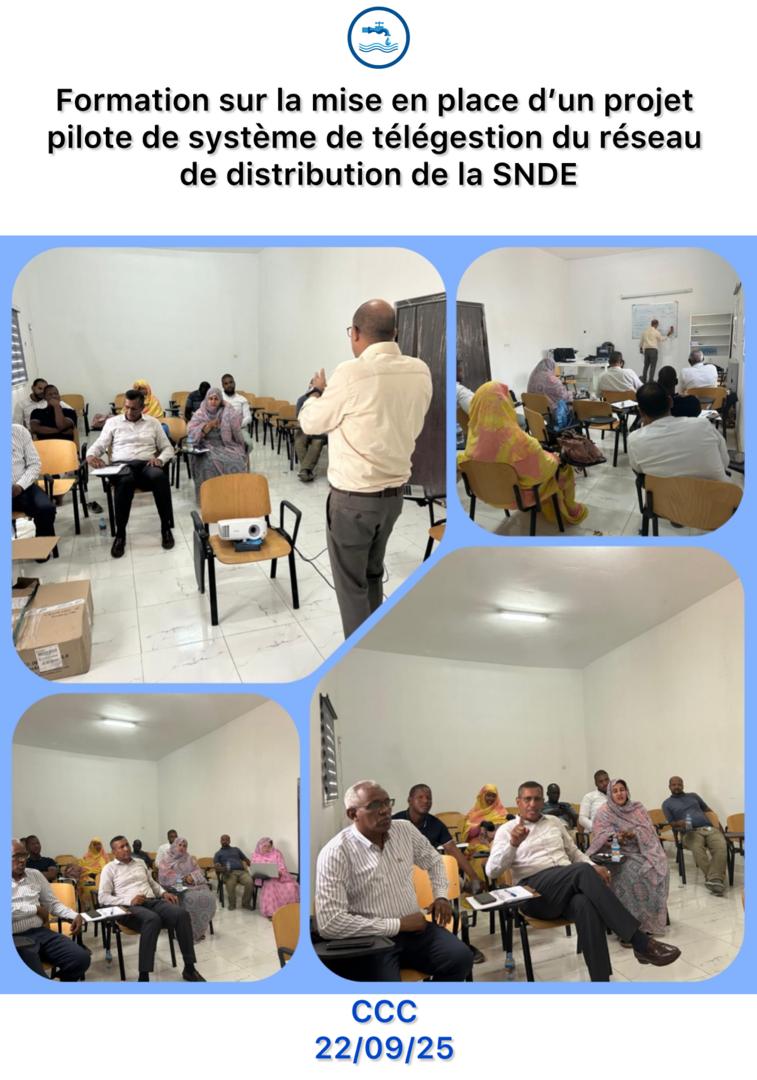
.gif)








.gif)