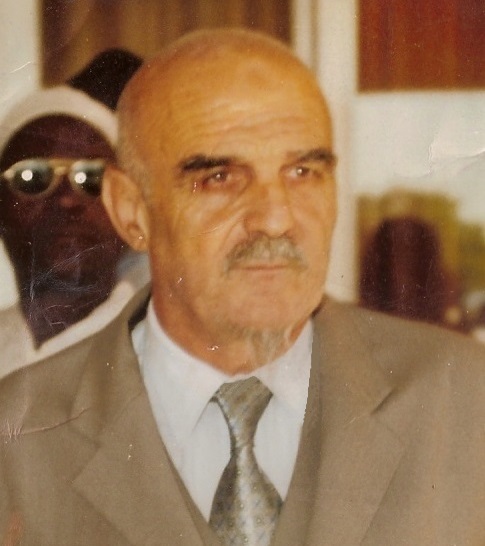
La civilisation à la croisée des questions
L’idée de la libre coopération repose, en première analyse, sur notre vie intra-utérine (1). Tout comme celle de la domination, sur les affres de la naissance. De plaisant, l’environnement devient soudain oppressif… Sans revenir ici sur les illustrations mythologiques – Âge d’or et Âge de fer, Paradis et Chute… – de cette réalité incontournable, on avancera plus extensivement que c’est d’abord les variations des cycles climatiques qui ont introduit la faim et les bisbilles consécutives entre les hommes confrontés à leur survie. Spontanément amenés à se regrouper en clans, il leur a fallu constamment naviguer entre coopération et conflit avec leur environnement. Apprivoisement, domestication, maîtrise, combat, servitude, esclavage ont ainsi hiérarchisé nos rapports avec la Nature et entre nous. Avec bientôt, comme je le signalais tantôt, des appétits croissants chez certains de ceux-ci et une monétarisation des échanges où tout, y compris la vie d’une personne humaine, s’est retrouvé peu à peu quantifié.
Moteur de cette évolution, la civilisation – ici en son sens très général d’organisation sociale par et pour la cité – a ainsi imposé, par à-coups (2), une dénaturation de nos rapports avec l’environnement, en le couvrant d’images, de meubles et d’immeubles, aujourd’hui tous monnayables. Un langage d’initiés longtemps interdit à la majeure partie du continent africain, notamment ses parties équatoriale et sub-saharienne, riches de tant de diversité animale et végétale, a contrario des espaces plus nordiques ou orientaux, plus souvent affamés et donc de beaucoup plus bonne heure experts en civilités. Entamée à l’Est le long des côtes de l’océan Indien, dès au moins le 3ème millénaire avant J.C. (3), par des commerçants indiens, mésopotamiens, arabes (notamment omanais et yéménites) ou encore bantous (notamment swahilis), l’exploitation de ces immenses ressources s’est étendue plus tardivement à l’Ouest, propulsée par le commerce méditerranéen.
Il s’y distingue d’abord, au cours du 1er millénaire avant J.C., deux peuples sémites : les Phéniciens et les Hébreux, les premiers polythéistes et les seconds monothéistes. La religion de ces derniers s’était lentement formée, au cours du précédent millénaire, au contact de deux autres voisines, le mazdéisme perse et le culte d’Aton égyptien, avec le souci de s’en distinguer nettement pour former une entité spécifique. Une situation ambigüe entre jointure et autonomie qui va constituer le leitmotiv central du développement de cette communauté périodiquement confrontée, au cours de son histoire, à l’esclavage par ses puissants voisins. C’est, de fait, entre soumission et libération que s’est écrite celle-ci, avec parfois des ambiguïtés paradoxales, notamment dans le positionnement vis-à-vis de l’exploitation des non-juifs (goys).
Prémisses de l’essor commercial transsaharien
Pour l’heure, l’intégration en Afrique du Nord de ces deux communautés associées semble s’opérer sans conflit notable à partir de la ville de Carthage (sur la côte orientale de l’actuelle Tunisie), alors que le développement de l’Assyrie, un nouvel empire conquérant au Nord de la Mésopotamie, entretient en permanence l’émigration des minorités sémitiques vers les rives méridionales de la Méditerranée. Mais l’apparition de nouvelles forces maritimes – grecque en Méditerranée orientale, quatre siècles à peine après la fondation de Carthage, et surtout romaine, deux siècles plus tard en Méditerranée occidentale – désorientent peu à peu le sens des échanges commerciaux.
Si les phéniciens carthaginois vont épuiser leurs forces dans leur conflit avec Rome, les juifs maghrébins, avant leurs homologues palestiniens, plient pour leur part le dos et intègrent le nouvel ordre en cours, fondant même, en Europe de l’Ouest elle aussi peu à peu soumise aux Romains, tout un chapelet de petits relais commerçants liés par leur religion commune et docilement assujettis aux services de leurs nouveaux maîtres, avant d’en acquérir la citoyenneté, suite à l’édit de Caracalla (212 après J.C.). Une tendance renforcée par des ententes épisodiques, sur le continent africain, de leurs communautés-sœurs avec telle ou telle tribu berbère (4), dans le lent établissement d’étapes (5) vers le pays des Noirs. Ils y rencontrent des espaces variablement civilisés, parfois de longue date, notamment dans le delta intérieur du Niger, sur lesquels vont bientôt se construire le commerce des esclaves. (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : À commencer par l’union entre un ovule et un spermatozoïde, éblouissant rappel de l’Unité principielle (1 + 1 =1)
(2) : Suite à des conflits, essentiellement commerciaux, entre cités avides d’augmenter leur orbe d’influence ; puis plus souvent territoriaux, au fur et à mesure que ces dernières s’affirment en États souverains.
(3) : Une antériorité qu’explique la profusion de civilisations plurimillénaires chinoises, indiennes, mésopotamiennes, égyptiennes, etc., directement ouvertes sur l’océan Indien…
(4) : Dont quelques-unes se sont même judaïsées, notamment parmi les Zénètes.
(5) : En particulier dans l’aquifère zone oasienne du Touat, longtemps plaque tournante de tout le commerce transsaharien, depuis au moins le 4ème siècle après J.C., on y reviendra. Voir, par ailleurs, Richard Ayoun, « Communautés juives des marges sahariennes du Maghreb », édité par Michel Abitbol (1982).





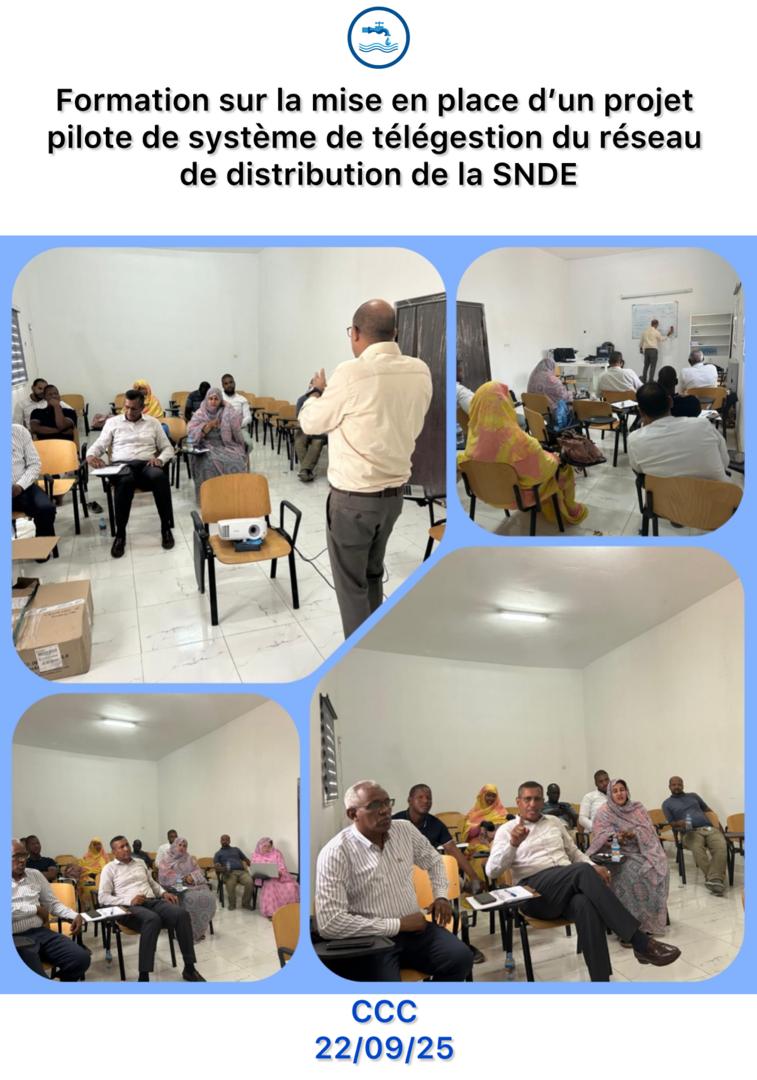
.gif)








.gif)