
Il y a une dizaine de jours, notre directeur de publication, Ahmed ould Cheikh, se voyait convié à une rencontre internationale à Zagreb (Croatie). Au-delà de la reconnaissance factuelle de l’audience de votre hebdomadaire préféré au sein de la Francophonie, cette invitation signalait la nécessité de la présence de la société civile mauritanienne dans ces débats autour de la Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel. Car le passé minier est toujours présent, en Mauritanie. Selon le Programme national de déminage humanitaire pour le développement (PNDHD), on a en effet dénombré, entre 1978 et 2000, 343 décès et 239 blessés graves, principalement dans les régions du Nord. Le nombre total de victimes depuis 1982 se chiffre en milliers, les civils – notamment les enfants et les éleveurs – constituant la majorité des pertes.
Une situation à peine moins dramatique qu’en Algérie où l'Observatoire des mines a enregistré, entre 1999 et 2022, 1 200 victimes de mines, dont environ 70 % de civils, parmi lesquels 200 enfants. Rien qu'en 2022, 15 nouveaux incidents ont fait 20 victimes, principalement près des frontières. Les autorités algériennes estiment que depuis l'indépendance, plus de 7 000 personnes ont été tuées ou blessées, avec un pic dans les années 1990 où l'on dénombrait jusqu'à 200 décès par an. Les mines datant de l'époque coloniale en Tunisie ont également fait des milliers de victimes dans les régions frontalières. Selon la Commission Vérité et Dignité (IVD), les opérations militaires françaises ont fait, entre 1956 et 1961, plus de 7 000 victimes tunisiennes, notamment des victimes d'attentats à la mine dans les montagnes du Sud et du Nord. Depuis, on recense encore 10 à 20 incidents par an, principalement parmi les éleveurs et les agriculteurs.
Et la cruelle vérité est là : alors que la Convention d'Ottawa de 1997 interdisant les mines antipersonnel est souvent présentée comme une avancée humanitaire, elle révèle, en Afrique et plus particulièrement dans les pays du Maghreb (Algérie, Mauritanie et Tunisie), une injustice flagrante, ancrée dans l'histoire coloniale. La France, ancienne puissance occupante, a laissé sur le territoire de ces nations des millions de mines qui continuent de mettre en danger les populations locales. Mais, au lieu d'assumer ses responsabilités, elle se soustrait à ses obligations, tandis que les media internationaux gardent un silence complice, afin de ne pas nuire à l'image des initiatives humanitaires.
La Convention d'Ottawa ne prévoit aucun mécanisme contraignant les anciennes puissances coloniales comme la France à financer ou à mener des opérations de déminage dans les pays affectés par leurs actions. L'Algérie, la Mauritanie et la Tunisie – toutes trois signataires (respectivement en 2001, 2000 et 1997) – doivent financer elles-mêmes les efforts de déminage, malgré des ressources limitées. Par exemple, l'Algérie a achevé, en 2017, le déminage d'une partie de la ligne Challe, un projet financé par son budget national à hauteur de plusieurs millions d'euros, sans aucune compensation de la part de la France. De même, la Mauritanie a bénéficié de l'aide des États-Unis mais d'aucune de la France, tandis que la Tunisie repose sur ses propres forces. Au lieu d'alléger leur fardeau, la Convention leur impose, de fait, des obligations de conformité… sans s'attaquer aux problèmes hérités du passé.
Vers une réforme affinée de la Convention d’Ottawa
Certes, la situation s’est compliquée avec l’apparition de nouvelles bombes artisanales – désormais qualifiées d’Engins Explosifs Improvisés (EEI) –, lors des conflits qui ont suivi : notamment la guerre du Sahara occidental, en Mauritanie (1975-1978), la guerre civile en Algérie dans les années 1990, les menées djihadistes, en Tunisie, à partir de 2012, avant de s’étendre à tout le Sahel. Mais le fond du problème reste lié au défaut de gestion de la décolonisation occidentale et c’est très certainement à partir de cette indispensable remise en ordre que doivent se rediscuter les termes du Traité d’Ottawa. Il va tout d’abord s’agir : d’imposer une responsabilité en cas de mauvaise utilisation et de contamination datant de l'époque coloniale ; de maintenir un déminage rigoureux des anciennes mines et de garantir la transparence et les inspections. Puis de prévoir des exceptions défensives pour les États attaqués, en établissant, à cette fin, des normes pour un nouveau type de mines dites « éthiques » et autoneutralisantes.
On parle ici d’engins « intelligents », uniquement activés contre des cibles militaires légitimes ; s’auto-neutralisant automatiquement après des périodes prédéfinies, surveillés à distance sous contrôle international et réservés aux États soumis à des attaques extérieures. L’avenir ne réside donc plus dans l’interdiction – fondement de la Convention initiale d’Ottawa en1997 (voir encadré ci-joint) – mais dans une réglementation éthique protégeant les civils et la souveraineté. Un traité repensé peut unir le Droit humanitaire à la justice et à la responsabilité, transformant une interdiction en un cadre de responsabilité morale. Dans quelle mesure la conférence à Zagreb des 10 et 11 Novembre derniers a-t-elle fait avancer les choses en ce sens ?
Ben Abdalla
------------------------------------------
Encadré : la Convention ouverte à la signature les 3 et 4 Décembre 1997 à Ottawa
Chaque État partie s'engage à :
- ne jamais employer, mettre au point, produire, acquérir, stocker, conserver ou transférer à quiconque de mines antipersonnel (art.I) ;
- détruire toutes les mines antipersonnel en sa possession au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie (art.IV) ;
- détruire toutes les mines antipersonnel présentes sur des zones de son territoire dans les dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État partie et après les avoir identifiées et signalées (art.V) ;
- fournir et/ou demander assistance auprès des autres États parties pour remplir ses obligations, si possible et dans la mesure du possible (art.VI) ;
- prendre toutes les mesures législatives appropriées pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la Convention (art.IX).
Il peut cependant conserver un faible nombre de mines antipersonnel afin de former aux techniques de détection, déminage et destruction des mines (art.III).




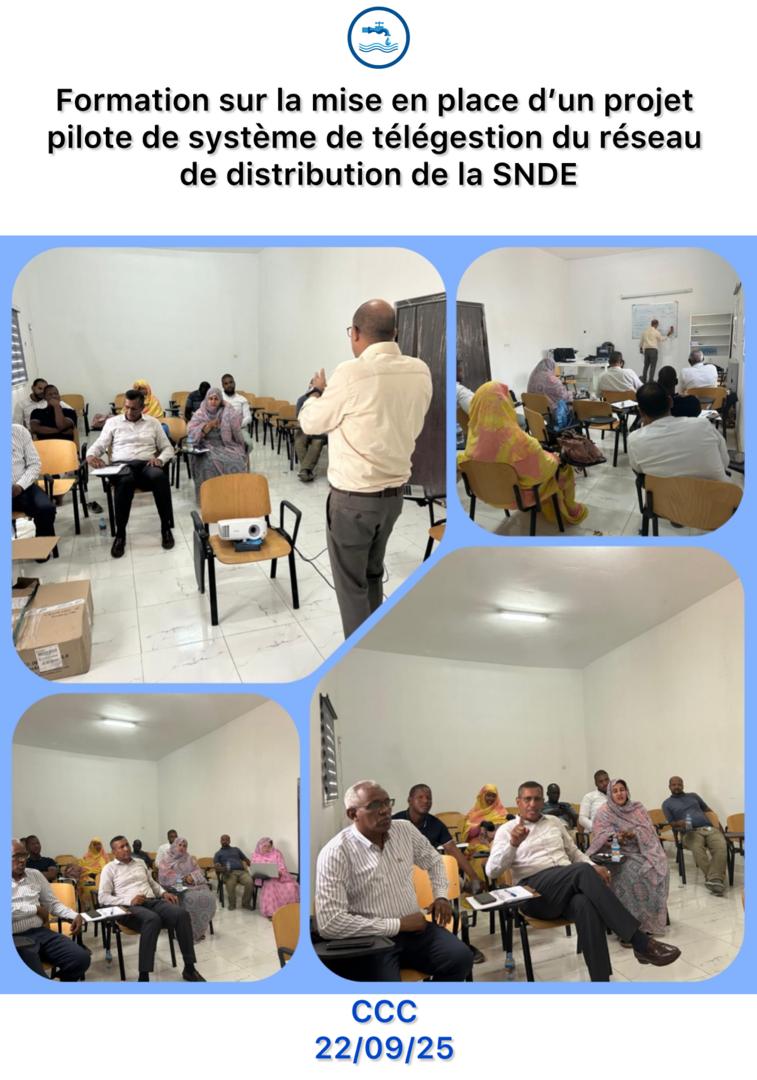
.gif)








.gif)