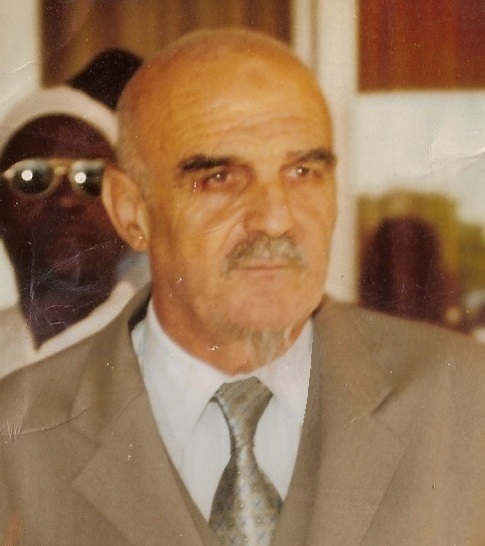
Un khalifat longtemps inassumé
Quels protestants ou juifs s’insurgèrent-ils, lors des guerres indiennes aux USA, contre l’extermination systématique des bisons et la déforestation outrancière menées par les colons avides de terres cultivables ? Quels missionnaires catholiques français, dans l’occupation des sols au Cayor pour y lancer la production d’arachides ? Et l’on cherche tout aussi vainement les éventuelles fatwas qui se seraient efforcées de limiter de tels excès (1) dans ce que les Européens laissaient d’espaces aux musulmans, notamment en ce qui concerne l’extraction des minerais… Bref et sans rentrer, ici encore, dans une vaine polémique comptable sur des dégâts que les unes et les autres ont infligés à l’environnement, il paraît incontestable que les religions du Livre ne sont pas particulièrement manifestées, au cours de l’Histoire, dans la protection de celui-ci ni dans l’intelligence du durable : ce fut, en gros et pour tous, le droit des profits à court terme, jusqu’à épuisement des sols et des stocks, sans jamais se préoccuper prioritairement des diverses pollutions que générait cette négligence à assumer le khalifat que Dieu confia à Adama (PBL).
Le cas des matières plastiques étroitement associées aux industries pétrochimiques est ici particulièrement éloquent. Selon la Fondation Heinrich-Böll, plus de neuf milliards de tonnes de matières plastiques ont été produites entre 1950 et 2017, à un rythme sans cesse accéléré : deux millions de tonnes en 1950 contre plus de quatre cents millions de tonnes en 2017. Cette production émet d'énormes quantités de gaz à effet de serre : d'après le Center for International Environmental Law, elle pourrait atteindre, en ajoutant l’incinération, « cinquante-six milliards et demi de tonnes de CO² en 2050 », avec de graves conséquences sur le climat. 40% de cette production ont été absorbés par le secteur de l'emballage dont chacun d’entre nous, en Mauritanie, peut constater les pollutions visuelles : enveloppes de bonbons, sachets d’Omo et autres sacs en plastique gratuitement délivrés par le moindre boutiquier du coin et qui finissent tous par se retrouver dans nos rues. Avant de revenir sur l’irresponsabilité individuelle que cette situation révèle, voyons d’abord ce qu’elle implique très loin de nos regards. Au printemps 1997, le bateau d’un océanographe, Charles J. Moore, s’est retrouvé coincé dans une immense plaque – plus de trois fois la surface de la Mauritanie ! – de débris de plastique dérivant dans le Pacifique Nord et l’on en a, depuis, découvert quatre autres, notamment dans l’océan Atlantique.
Plastification du Monde… et de l’Humanité ?
Non pas, bien évidemment, que les Africains – et donc les Mauritaniens – soient les principaux responsables de ce drame ; loin de là, puisque les Européens, par exemple, consomment en moyenne quinze fois plus de matières plastiques qu’eux. Mais les conséquences de cette plastification mondialisée n’en affectent pas moins tout le monde et nous obligent, chacun selon ses moyens, à tenter de réparer les dégâts ; à tout le moins les limiter, tant se faire que peut. En commençant par en comprendre l’étendue : fragmentables jusque dans les plus petites dimensions – on parle de micro-, voire de nano-plastiques – ces produits artificiels ne sont jamais réellement intégrés par les organismes vivants et les affectent dans leurs plus vitales fonctions. En ce qui concerne la seule mer Méditerranée, où « plus de deux cent cinquante milliards de ces microfragments flottaient, en 2010, au large des côtes », […] « 36 % des espèces d’oiseaux de mer et 43 % des mammifères marins sont affectées par ces déchets ; et pour longtemps, les polymères mettant mille ans à se dégrader entièrement (3). » Et l’on entend bien, ici, que monsieur et madame « Tout-Le-Monde » se sentent totalement impuissants devant la complexité de cet effarant désastre. C’est bien évidemment en très hauts lieux que doivent s’en discuter les éventuelles solutions. (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Pourtant si souvent et explicitement condamnés dans le Saint Coran. Voir, par exemple : « N'obéissez pas à l'ordre des outranciers qui sèment le désordre sur la terre et n'améliorent rien » (26 : 151-152) ; « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin que Dieu leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré ; peut-être reviendront-ils… » (30 : 41) ; sans oublier, cependant, la Grâce toujours possible : « Dis : “Ô Mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux. » (39 : 53) ; qui ne dispense en rien – bien au contraire – de s’appliquer à la mériter, comme l’a si bien rappelé Mohamed PSL : « Si la fin du Monde vous surprenait en pleine plantation de palmier, appliquez-vous dans votre travail jusqu’au bout. »
(2) : Ainsi que le notent diverses études. Voir, par exemple, « D’ICI À LÀ », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2024, pp. 228-231.
(3) : Voir les études des ONG « Expéditions Méditerranée en danger » et « Sea Shepherd ».



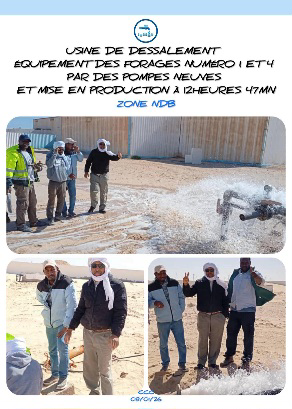

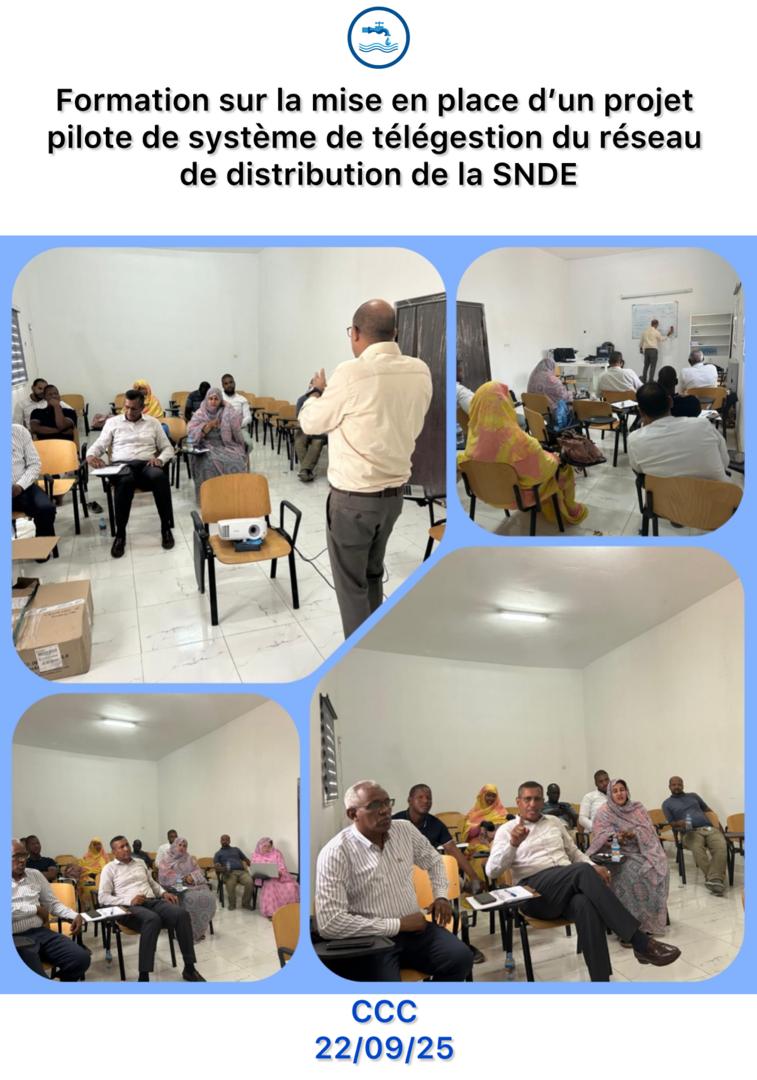
.gif)








.gif)