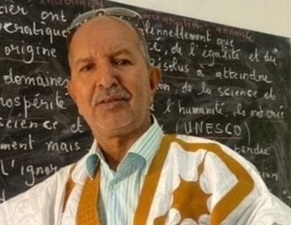
La Mauritanie de son excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani présente un paradoxe saisissant. Salué pour sa stabilité dans une région en proie à l'instabilité, le régime est néanmoins la cible de critiques virulentes, notamment du Département d'État américain et d'ONG comme Human Rights Watch. La question centrale n'est pas de savoir si ce pragmatisme est efficace à court terme, mais s'il sert un véritable intérêt national ou s'il ne fait que consolider un pouvoir fragile sur des fondations instables, au détriment de l'intérêt général.
Un leadership entre realpolitik et failles internes
Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, le président Ghazouani, ancien général, a adopté une approche que beaucoup qualifient de realpolitik. Il a su naviguer avec habileté entre les alliances militaires stratégiques avec l'Occident dans la lutte contre le terrorisme et des relations diplomatiques avec des puissances comme la Russie et la Chine. Cette posture a, sans conteste, épargné au pays les convulsions immédiates.
Cependant, cette stabilité masque des lacunes structurelles profondes. Le pays est confronté à une corruption systémique, une gestion économique inefficace et une défaillance des services publics qui alimentent le mécontentement populaire. La mauvaise gestion de projets de développement majeurs est une sonnette d'alarme pour la gouvernance. L'arrestation récente également de manifestants, dont le militant écologiste Ely Ould Bakar et l'homme politique Dr. Ahmed Ould Samba, révèle une intolérance croissante envers les voix dissidentes, étouffant les libertés d'expression et d'association et instaurant un climat de méfiance généralisée.
Un développement confisqué et des tensions identitaires
Malgré un sous-sol riche en ressources (fer, or, cuivre, pétrole, gaz et autres), un littoral poissonneux, des parcs nationaux et espaces naturels touristiques, la richesse est loin d'être équitablement répartie. Un rapport de la Banque Mondiale de 2024 révèle que 30% de la population vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre d'autant plus alarmant qu'il s'accompagne de profondes inégalités sociales et ethniques.
Au-delà des tensions entre les communautés arabo-berbères et les Haratines (descendants d'anciens esclaves), qui n'ont jamais été réellement résolues, une autre crise identitaire fondamentale persiste : celle des Négro-Mauritaniens. Ces communautés, incluant les Peuls, Soninkés, Wolofs, estiment être délibérément marginalisées par l'État. Cette exclusion touche la représentation politique et administrative, l'accès à l'emploi et aux ressources, ainsi que la reconnaissance culturelle, renforçant le sentiment de discrimination.
La persistance de l'esclavage sous des formes contemporaines demeure une tache indélébile sur le bilan du pays. La concentration du pouvoir et le manque d'inclusivité dans les processus décisionnels suggèrent que la pérennité du régime prime sur l'intérêt général.
La nécessité de la réforme face au regard extérieur
La Mauritanie ne peut pas se permettre d'ignorer les critiques internationales. Les rapports du Département d'État américain et des ONG ne sont pas de simples déclarations ; ils ont des conséquences tangibles sur l'aide internationale et les investissements étrangers, dont le pays est fortement dépendant. Ignorer ces signaux, c'est mettre en péril le développement à long terme de la nation.
La véritable sagesse ne réside pas dans la survie d'un régime, mais dans sa capacité à se réformer de l'intérieur pour mieux servir son peuple. Pour la Mauritanie, cela implique des actions concrètes :
- Mener une lutte contre la corruption qui s'attaque aux racines du mal.
- Instaurer une justice indépendante qui garantisse les droits fondamentaux pour tous.
- Engager un dialogue sincère et inclusif avec la société civile et les communautés marginalisées pour restaurer la confiance et construire un avenir commun.
La Mauritanie est aujourd’hui à la croisée des chemins
Il appert que le leadership du président Ghazouani devra choisir entre la perpétuation d'un statu quo autoritaire et la mise en œuvre d'une refonte démocratique authentique. L'histoire jugera si la sagesse a prévalu sur la simple realpolitik.
Eléya Mohamed
Notes amères d'un vieux professeur





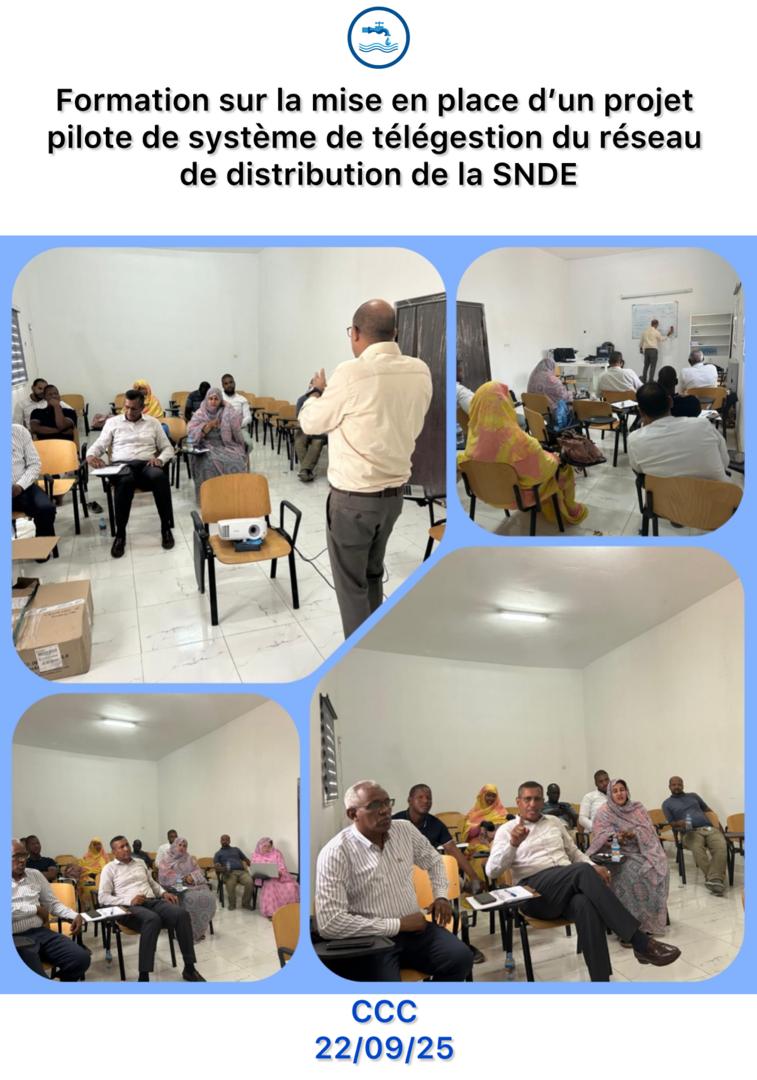
.gif)








.gif)