
Sensible, comme on l’a vu tantôt, dès l’apparition du mouvement zawaya, l’influence française n’a cessé au cours de ces siècles de se renforcer, plus ou moins contrecarrée par les Hollandais, puis surtout les Anglais installés sur la Côte de l’Or (1624) et en Gambie (1661) où les petites communautés juives se voient renforcées dans leur commerce par le rétablissement, en 1656, de leurs coreligionnaires en Angleterre (1). Bien d’autres intermédiaires locaux interviennent dans ces transactions : des plus douteux trafiquants à des véritables institutions étatiques, à l’instar de l’empire Ashanti, gros fournisseur d’esclaves aux Européens mais néanmoins opposé à toute pénétration de ceux-ci sur son territoire. Un antagonisme de fait assez généralisé en Afrique de l’Ouest obligeant ceux-ci à des manœuvres en sous-main afin de diviser pour régner. S’il semble ici hasardeux de prétendre élucider ces stratégies souterraines, on peut tout de même relever quelques pistes en ce sens, à l’instar, nous en avons déjà parlé, de la fourniture d’armes légères françaises aux tribus hassanes lors de la guerre de Char Bebbe ou anglaises aux troupes d’El Hajj ‘Omar Tall, avec, en cette dernière occurrence, l’objectif assez évident de freiner la poussée des Français vers l’Est du Continent.
Nouveaux enjeux et visages de l’esclavage
Cette pénétration s’était tout d’abord matérialisée dans l’établissement, au cours des dernières décennies du 18ème siècle et des premières du 19ème, d’« escales » commerciales le long du cours inférieur du fleuve Sénégal, moyennant le paiement de « coutumes » aux potentats locaux – maures, toucouleurs, soninkés, etc. – impliquant, de part et d’autre, toute une complexité de négociations, diplomaties, ruses, dessous-de-table, détournements de fonds – et de principes… – sans jamais omettre, côté français, d’entretenir suffisamment de dissensions afin d’éviter tout regroupement susceptible d’imposer sa loi. De fait, la situation générale, au milieu du 19ème siècle, ruisselle d’embrouilles entre les diverses communautés ouest-africaines, notamment musulmanes et animistes, dans un climat tendu d’anarchie où la France va enfin pouvoir s’avancer en « pacificatrice » et ordonnatrice de « progrès ». Trop souvent obnubilés par des intérêts à court terme, peu de dirigeants sahéliens perçoivent alors l’étendue des objectifs tapis sous cette couverture…
El Hajj ‘Omar Tall est de ceux-là. Sans présumer, ici, de la profondeur spirituelle de ses visées, il faut s’arrêter un instant sur sa perception globale des entreprises européennes en cours. Son séjour prolongé à La Mecque et en Égypte – dix-huit années, de 1827 à 1845 – l’a mis en contact plus ou moins direct de celles-là au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ses rencontres avec diverses notabilités musulmanes – notamment le cheikh marocain Mohammed al-Ghâlî qui l’initie, avant de mourir, au wird de la Tijaniya – et plus particulièrement ottomanes qui l’instruisent des transformations sociétales en Europe et des menées rivales de l’Angleterre et de la France, lui permettent de mieux comprendre ce qu’il avait lui-même perçu dès son adolescence au Fouta Toro (2). Mais, certainement pas, hélas, dans un tel milieu où la traite des esclaves était une composante indiscutable du pouvoir, la nécessité de concevoir la résistance à celles-là dans une coopération entre toutes les sensibilités spirituelles africaines.
Cette carence d’entendement est d’autant plus lourde de conséquences qu’après s’être gavés d’exportation massive d’esclaves pour leurs besoins de main-d’œuvre servile en leurs colonies américaines, les Européens se targuent désormais de promouvoir des droits humains « universels » dont le respect va maintenant devenir un leitmotiv récurrent dans la conduite du Monde soumis aux impératifs d’une production démentielle d’objets et de produits conçus et fabriqués en Occident, à partir de matières premières méthodiquement ratissées ailleurs, notamment en Afrique. Car le nouveau système mis en place à partir de la révolution industrielle enclenchée dès 1689 en Angleterre a moins besoins de bras – les machines sont désormais en place – que de bouches et d’excitations d’appétits. Il lui faut un nombre toujours croissant de consommateurs suffisamment pourvus en liquidités – et constamment abrutis de publicités sur le marché… – pour rentabiliser la production mécanisée (3). (À suivre).
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Voir « GENS DU LIVRE […] », (Prix Chinguitt 2006), Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2ème édition 2025, pp. 90-91.
(2) : Sous l’influence notable de son maître d’études originaire du Fouta Djalon où la vente d’esclaves à des Européens a pris une dimension considérable que le jeune révolutionnaire entendra contester dans la conduite de son propre mouvement à partir du Mali.
(3) : Pour un peu plus de détails, voir notamment mon autre ouvrage « D’ICI À LÀ », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 1ère édition 2025, pp.371-402.





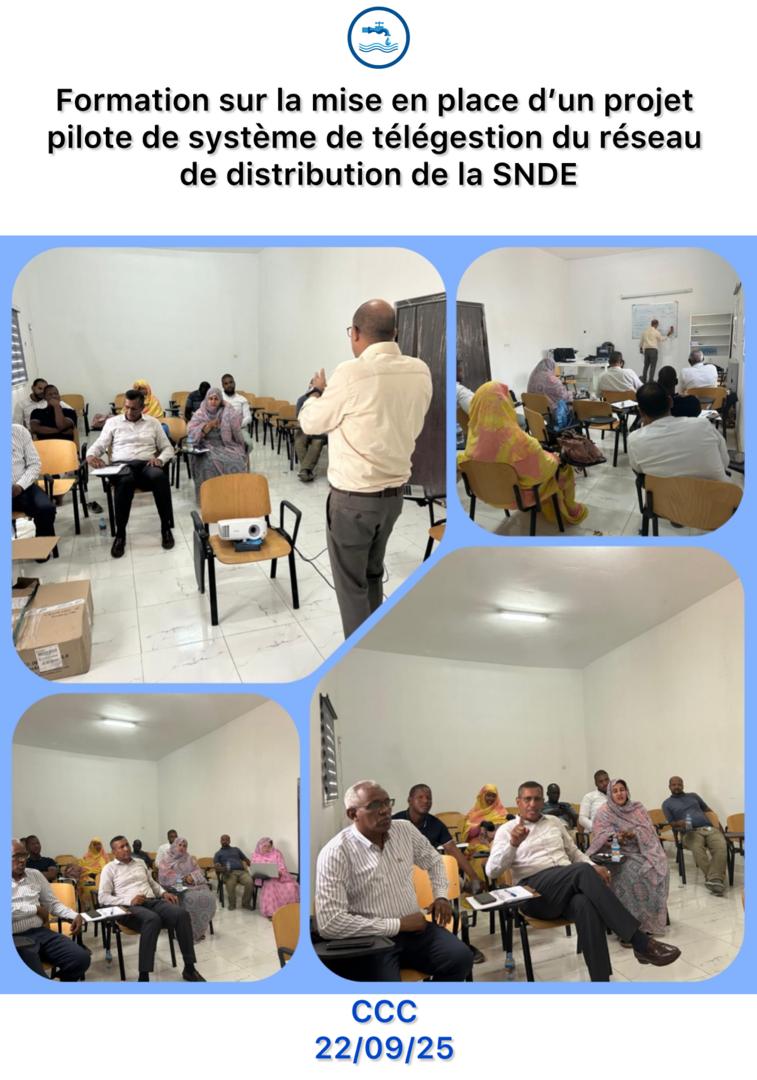
.gif)








.gif)