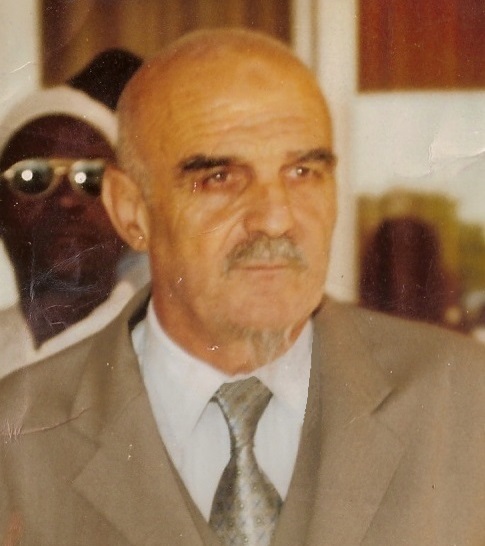
Toute vie implique une relation avec son environnement. Environnement au sens large : naturel – minéral, végétal, animal – et culturel, soit, pour les humains, la famille proche, le voisinage domiciliaire, le quartier ou le village, les diverses communautés, notamment de travail, de langue, de race, de nation ou autres. Avec, dans tous ces rapports, la question de l’aisance personnelle, variablement régulée par des codes moraux censés encadrer les rapports de force entre tous ces groupements et leurs nécessités respectives.
Dans cette organisation du vivant, de profonds déséquilibres sont aujourd’hui patents. Le système socio-économique (1) développé à partir de la révolution industrielle déclenchée en Occident au 18ème siècle semble avoir dépassé tous les précédents cadres naturels et moraux, au détriment global de la vie partout sur cette terre (2) et, plus particulièrement, de l’aisance personnelle d’une majorité croissante d’humains écartelés entre leur nature, leurs convenances ancestrales et l’adaptation à ce système. Plus que jamais, vivre en société signifie, pour l’humain, porter un « masque » (en latin « persona »), au sens propre comme au sens figuré. Et ce n’est ni anodin ni fortuit que le mot « personne » soit à la fois significatif d’un vide, d’une absence – « il n’y a personne ici » – et un concept si central de nos jours dans la définition juridique de l’humain : personne physique ou morale, privée ou publique.
La « gestion » de ce déséquilibre suscite beaucoup de commentaires et critiques. Il s’en résulte un paradoxe insuffisamment exploré, selon moi : alors qu’une nette majorité d’humains semble ne pas se faire à ces malaises, il semble impossible qu’elle parvienne à s’unir pour y trouver des remèdes consensuels. Cela va du passéisme le plus terroriste au transhumanisme le plus radical, en passant par toute une gamme de positions entre religiosité et laïcité, notamment dans l’encadrement de l’espace public. Dans ce contexte général, certains évènements dramatiques hautement médiatisés, à l’instar du conflit en Palestine, tendent à mondialiser et exaspérer ces antagonismes, les uns et les autres se contentant trop souvent de ne valoriser leurs qualités qu’en n’analysant les faiblesses de leurs « adversaires ». Dictature au final d’une « poudre aux yeux » – généralisée, en dépit de ses variations culturelles – guère de nature à nous ouvrir de plus heureuses perspectives dans notre rapport à notre environnement, au sens très général ci-dessus énoncé ?
Entre exploitation et coopération
La question recouvre celle de la domination. Pourquoi, comment, dans quelles limites ? Processus naturel ou culturel ? En dépit de ce que chercha à prouver « scientifiquement » Charles Darwin (3), ce n’est pas la compétition mais l’entraide qui est le moteur fondamental de l’évolution, comme l’a avancé notamment Jean-Baptiste de Lamarck (4). Avec cependant ceci qu’en situation de famine, c’est naturellement – instinct de conservation… – plus souvent la loi du plus fort qui l’emporte sur celle du partage. Un constat que les diverses sociétés humaines ont tendu à minimiser par des considérations morales, tout particulièrement l’éloge de la frugalité – plus généralement de la mesure en toute chose –, de la compassion et du respect des équilibres du Vivant. Avec des nuances particulièrement significatives des différences d’environnement naturel : climat, latitude, altitude, accès à l’eau… ; où se sont développées ces sociétés.
Dans cette série, on s’intéressera particulièrement à deux des plus problématiques expressions de cette domination entre humains : l’esclavage et son corollaire tardif, le racisme. Plurimillénaire, le premier est le fruit de multiples causes et comporte de nombreux aspects dont certains persistent plus ou moins visiblement aujourd’hui – on devra y revenir plus en détails – tandis que le second est surtout la conséquence de ses excès, notamment en Afrique où les religions monothéistes – islam et christianisme surtout mais aussi le judaïsme, en plus ou moins visible filigrane (5) – ont joué un rôle singulièrement important : à partir du 7ème siècle du dernier millénaire, pour le premier, et du 15ème, pour le second ; l’espace compris entre la Méditerranée et le Golfe du Lion constituant le théâtre privilégié de leurs manœuvres et fréquents affrontements. C’est pourtant d’abord à l’extérieur du continent africain, là où aboutirent les différentes traites du commerce esclavagiste, que se sont manifestées le plus explicitement ces différences. (À suivre)
Ian Mansour de Grange
NOTES
(1) : Produire, produire toujours plus de marchandises… et de spectacles pour en promouvoir la consommation auprès d’un maximum de gens. Voir notamment mon ouvrage « D’ici à là », Éditions Joussour Abdel Aziz, Nouakchott, 2024 ; pp. 373-405.
(2) : Détriment « global », en ce sens que, si beaucoup d’espèces sont en voie de disparition, d’autres, comme celle des humains mais aussi des insectes et autres micro-organismes anaérobies, sont encore en croissance numérique exponentielle. Mais à quelle hémorragie de qualité de vie et, surtout, jusqu’à quand ?
(3) : (1809-1882). Au 19ème siècle, donc, en plein essor dudit système économique…
(5) : dans une constante volonté transnationale et transectaire d’établir un continuum économique entre toutes ses petites communautés éparpillées sur les continents, notamment l’Eurasie et l’Afrique.





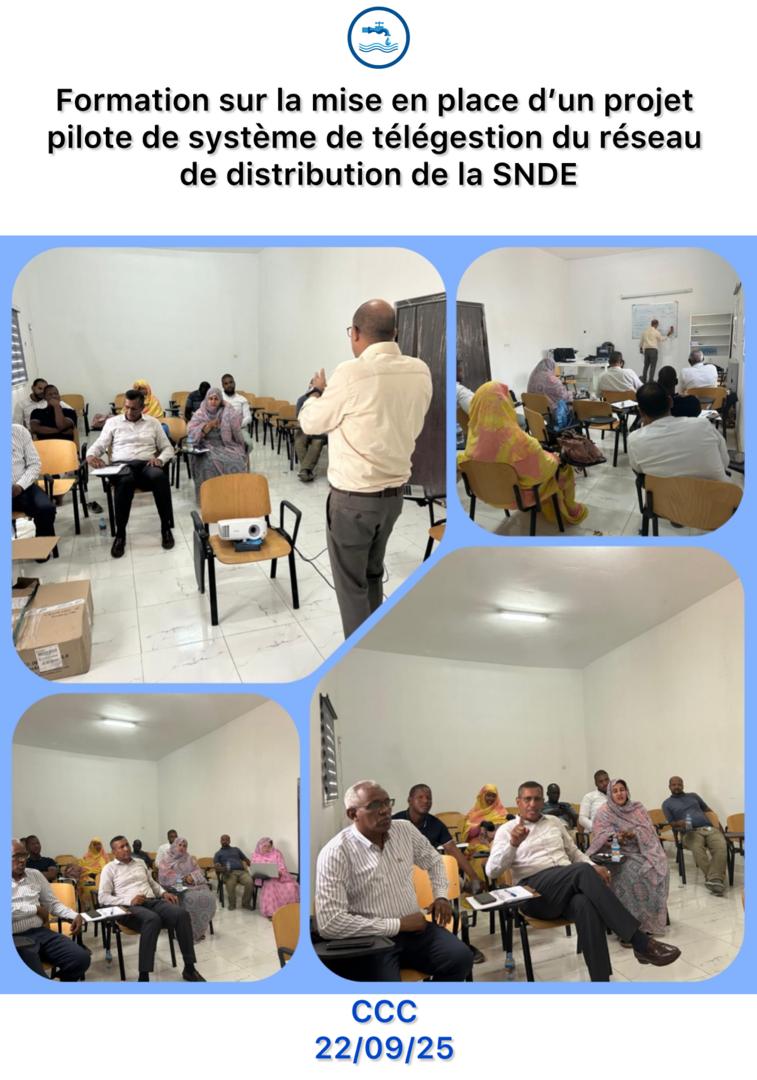
.gif)








.gif)