
Après plusieurs échanges enrichissants au sein de notre groupe Le Cercle des Idées, je commence à mieux saisir pourquoi le dialogue, en soi, revêt une importance capitale ; nonobstant la sincérité ou les intentions réelles des uns et des autres. Si la Mauritanie n’est pas aujourd’hui confrontée à une guerre civile, à un génocide ou à un effondrement de l’État comme l’ont été d’autres pays, c’est précisément une raison supplémentaire d’adopter, en amont et en conscience, une culture pérenne du dialogue. À ce titre, l’histoire récente de plusieurs nations offre des enseignements édifiants.
En Afrique du Sud, la fin de l’apartheid fut rendue possible non par la confrontation violente, mais par un dialogue historique entre l’ANC de Nelson Mandela et le régime en place, à travers la Convention pour une Afrique du Sud Démocratique. Ce processus, qui aurait pu sombrer dans la guerre civile, permit une transition pacifique, l’instauration d’un régime démocratique et la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, dans un pays longtemps fracturé par le racisme institutionnel.
En Tunisie, lorsque la révolution de 2011 menaçait de dérailler sous le poids des tensions politiques et des assassinats, c’est un quartet composé de syndicats, de patrons, de juristes et de défenseurs des droits humains qui prit l’initiative de médiatiser un dialogue national. Grâce à ce consensus civique, un nouveau gouvernement fut installé, une Constitution fut adoptée et des élections apaisées eurent lieu, sauvant le processus démocratique. Le pays reçut même le Prix Nobel de la Paix pour cet effort collectif.
En Colombie, un conflit armé vieux de plus de cinquante ans entre l’État et les guérillas des FARC fit plus de 200 000 morts. Et pourtant, au terme d’un dialogue de plusieurs années, un accord de paix fut signé en 2016, marquant une étape cruciale vers la pacification du pays, la réinsertion des anciens combattants et la réhabilitation des zones rurales longtemps délaissées.
Au Rwanda, après le génocide de 1994, où près d’un million de vies furent fauchées, c’est à travers un processus inédit de justice populaire ; les juridictions Gacaca ; et une politique active de réconciliation nationale que le pays entama sa reconstruction. En deux décennies, il s’est hissé parmi les pays les plus dynamiques du continent africain, preuve qu’un dialogue sincère, même après l’horreur, peut refonder une nation.
Enfin, en Indonésie, la chute du régime autoritaire de Suharto en 1998 ouvrit une période d’instabilité. Mais le pays choisit la concertation : réformes constitutionnelles, décentralisation, ouverture démocratique. Cette transition, marquée par un dialogue constant entre l’État, les forces politiques et la société civile, permit à l’Indonésie de retrouver sa stabilité et d’amorcer une forte croissance.
Ainsi, ces exemples montrent qu’aucun pays n’a attendu la catastrophe pour redécouvrir les vertus du dialogue. Le dialogue peut ne pas être une réponse de dernier recours à une crise, mais un instrument structurant de gouvernance, d’anticipation et de construction de la confiance nationale. Dans un contexte sahélien instable, dans un pays aux identités multiples et aux défis sociaux persistants, dialoguer, c’est prévenir l’implosion. C’est renforcer la résilience nationale, consolider la cohésion sociale et ouvrir des perspectives de réformes partagées. Choisir le dialogue en période de calme relatif, c’est faire preuve de lucidité politique et d’intelligence collective. C’est surtout transformer une précaution en opportunité historique : celle de bâtir un avenir stable, juste et inclusif, sans attendre que les fractures deviennent des failles.
Haroun Rabani





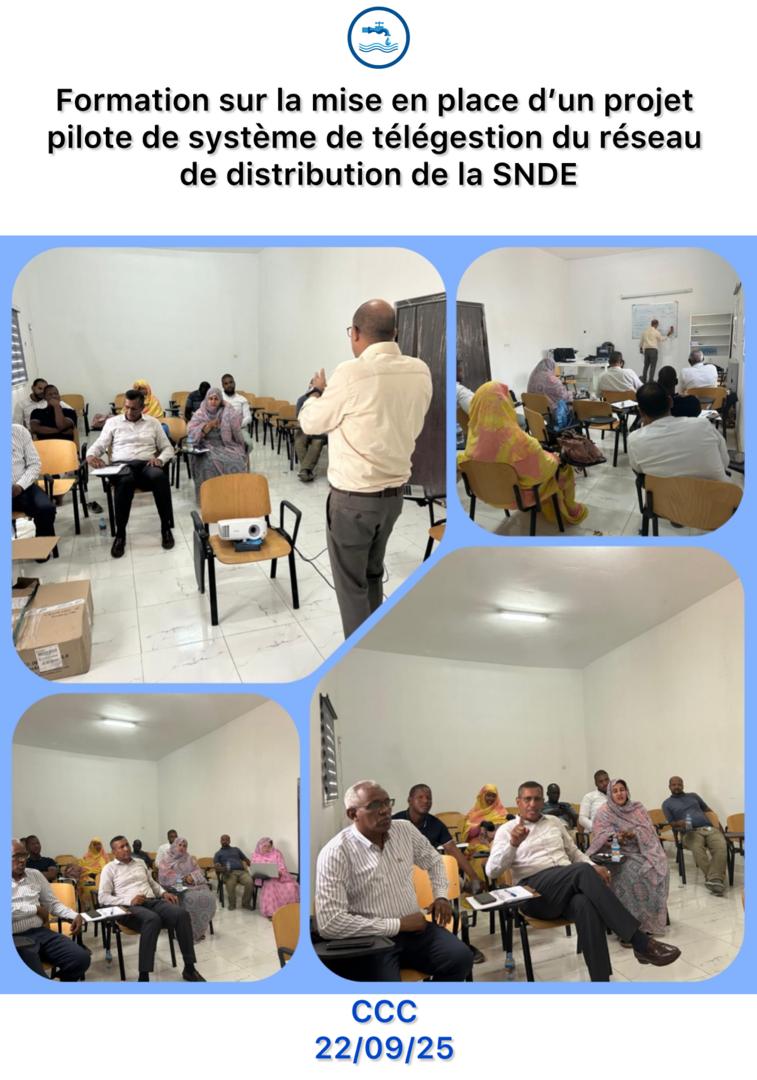
.gif)








.gif)