
Drogues, produits médicaux contrefaits, produits alimentaires périmés, narcotrafiquants… Le récent démantèlement de réseaux de produits psychotropes et de médicaments apparemment mêlés d’armes est venu rappeler aux Mauritaniens que ces produits nocifs circulent dans le pays depuis des décennies. Petit bout révélé de quel immense iceberg invisible ? Les media publics, la presse et le bouche-à-oreille nous content, par épisodes, la saisie de divers de ces produits et leur incinération par les forces de l’ordre, sans que l’on puisse être certain de l’élimination de ces substances très lucratives, notamment en ce qui concerne les drogues dures, à l’instar du cannabis ou de la cocaïne. En tout cas, une chose est certaine : la Mauritanie est un pays de transit. L’avion qui déposa une cargaison de drogue à l’aéroport de Nouadhibou en 2007 – une énigme dont on continue de parler aujourd’hui sans en comprendre les vrais ressorts – n’était pas un cas isolé.
Une mafia bien incrustée
Le démantèlement du réseau été opéré grâce, apprend-on, aux forces algériennes. Bourré de produits psychotropes, un camion en provenance de Mauritanie était arrêté chez nos voisins dont l’enquête révélait qu’il se dirigeait vers la Libye pour écouler sa cargaison. Poursuivies à Nouakchott par notre gendarmerie nationale, les investigations mettaient à jour plusieurs dépôts en divers quartiers de la capitale ; des mauritaniens arrêtés, en complicité probable avec quelques étrangers ; le tout démontrant l’existence de sérieuses failles dans la surveillance du Territoire. Pourtant sur nos routes et postes frontaliers, les forces de défense et de sécurité sont présentes et les contrôles d’identité stricts. Des compagnies de police, de gendarmerie et de la Garde chargées d’épauler la douane sont présentes dans les trois régions de Nouakchott… mais la drogue n’en creuse pas moins son lit.
Les arrestations récurrentes de jeunes avec des « joints » et les saisies consécutives de psychotropes ont fini d’interpeler les Mauritaniens – les autorités en premier lieu – sur la réalité du phénomène. On se rappelle que l’ancien président de l’Assemblée nationale, Cheikh Baya, alertait régulièrement sur la présence de drogues dans et aux alentours des écoles. En vain. Une mafia bien incrustée dans notre pays s’enrichit sans vergogne, introduisant avec une étonnante facilité ces substances, avant peut-être de les expédier ailleurs. Les signes de richesse qu’exhibent certains de nos concitoyens laissent perplexe. On peut certes puiser dans les caisses de l’État, bénéficier de marchés juteux dont on dépense à peine un tiers, laissant le reste de côté, mais cela n’est pas donné à tout le monde. Les dépôts de toutes sortes de produits psychotropes, drogues dures, médicaments importés illégalement et refourgués dans le commerce, au cœur même de la capitale, peuvent générer les richesses douteuses qu’on constate à Nouakchott : villas, châteaux, palais cossus, voitures dernier cri qu’aucun fonctionnaire de l’État ne peut s’offrir avec son traitement mensuel. Sans compter les voyages réguliers au Maroc, Espagne, Turquie ou autre et un train de vie dépassant l’imagination...
En 1997, un employé de la Société générale travaillant à Paris était venu faire un tour en Mauritanie et s’interrogeait sur le nombre de 4x4 y circulant. « On n’en voit que très rarement en France », signalait-il, « ici, on se croirait dans les pays du Golfe, avec les familles de princes et d’émirs… » Bien vu et l’on imagine mal, à ce constat, comment les autorités pourraient vaincre le signe indien que révèle cet étrange étalage. Le président Ould Abdel Aziz, d’abord, puis son successeur Ghazouani ont bien tenté d’éradiquer la corruption : en vain, jusque-là. Le premier fut attrapé lui-même par la gangrène et jugé en conséquence pour s’y être vautré. Ghazouani, a pour sa part, multiplié les instruments dans la lutte contre ce fléau qui génère tant d’injustices et de frustrations… mais les résultats se font beaucoup trop attendre.
Un système sans pitié pour nos gosses
Visiblement, quand on goûte à ce fruit pervers, on y reste accroché, tant quand on n’est pas envoyé derrière les barreaux, et, chose gravissime, cette toxicomanie semble toucher aujourd’hui tous les milieux : même les familles maraboutiques naguère insoupçonnables s’en voient désormais suspectées, tant elles exhibent, elles aussi, des richesses douteuses. S’enrichir, s’enrichir, au prix des pires dévoiements : comment peut-on importer des médicaments sans respecter les plus élémentaires règles d’hygiène et de conditionnement, vendre des produits contrefaits et périmés ? Est-ce de ce que les auteurs de ces « écarts » de conduite échappent à toute sanction ? Et l’on s’étonne, aussi, de la multiplication insensée des pharmacies – beaucoup plus souvent d’ailleurs, dépôts de pharmacie – conduits dans tous les quartiers par des vendeurs sans qualification, voire carrément analphabètes, prêts à vous vendre n’importe quoi sans ordonnance, jusqu’au cœur même de la capitale. Aujourd’hui que le démantèlement des filières mafieuses est annoncé et des arrestations opérées, on attend donc du pouvoir la plus grande fermeté. Plus question de coups de com, arrestations de sous-fifres, en attendant que le ballon se dégonfle, on n’en parle plus et hop ! Les pratiques illégales reprennent de plus belle ! Non, stop, une bonne fois pour toutes !
Car si ces drogues et produits nocifs enrichissent une catégorie de mauritaniens, ils rongent, hélas, trop de nos jeunes générations. Notamment au sein des plus pauvres d’entre elles : c’est en effet devenu banal, dans nos quartiers périphériques, de voir des jeunes se livrer à la consommation et à la vente de haschich, alcool frelaté et autres « pilules du bonheur »… Quand ils sont arrêtés par les forces de l’ordre, les voilà libres quelques jours plus tard, à reprendre leur commerce sans inquiétude. Même topo dans la Vallée où les jeunes fument et vendent de la drogue venue de l’autre côté du fleuve, sous l’œil complice des prétendus surveillants de la frontière. Les marchés hebdomadaires (loum) sont ainsi devenus des lieux ouverts d’approvisionnement en « yamba ». Nombre de parents ont fini de démissionner, certains seraient même entretenus par ces enfants vendeurs de malheur. Avec la complicité bien évidemment des voisins. Et je ne parle pas ici du facteur démultiplicateur de violence de ces produits psychotropes dont sont victimes même des mineurs. N’en jetez plus, la cour est pleine ! Je me « contenterai » donc de conclure avec une simple question subsidiaire : et où elle est, la Douane, en ce dossier brûlant ? Ses agents ne devraient-ils pas y être en première ligne ?
Dalay Lam





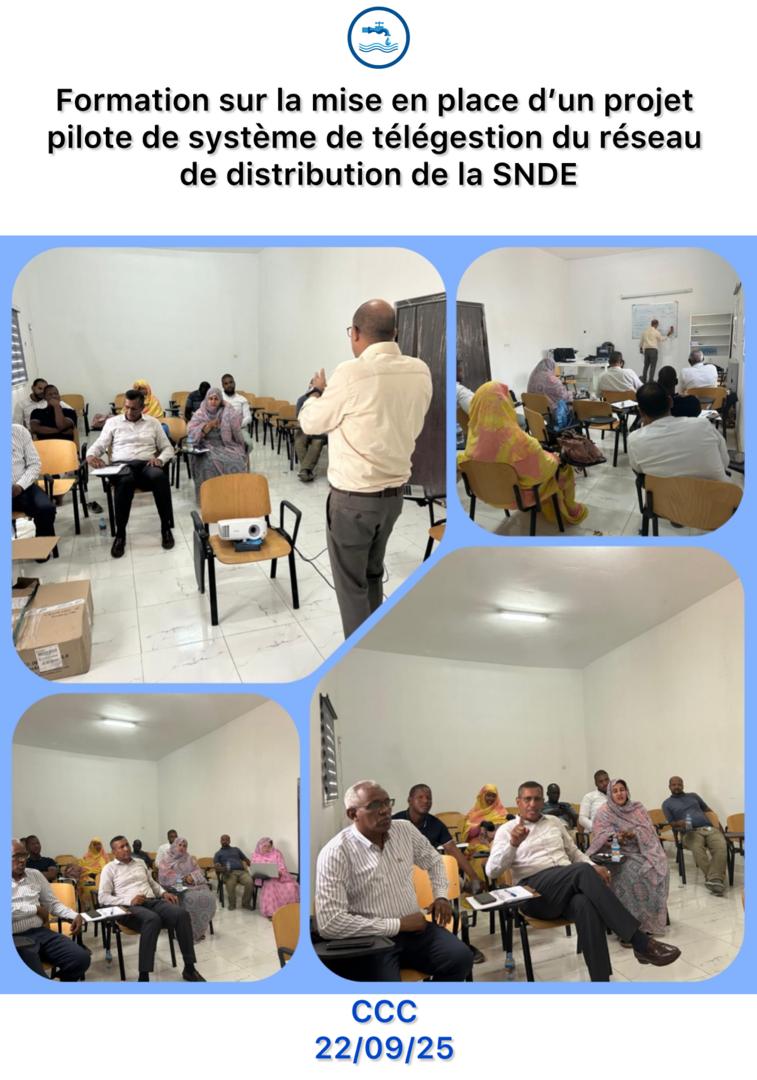
.gif)








.gif)