
Dans les nations africaines, l'armée nationale ne saurait se limiter à un rôle purement défensif ou stratégique. Bien au contraire, sa présence active dans tous les secteurs de la vie nationale s’impose comme une nécessité impérieuse pour préserver la stabilité institutionnelle, prévenir les dérives socio-politiques et contenir les tensions susceptibles d’être exacerbées par des discours haineux et opportunistes. S’appuyant sur des clivages ethniques, idéologiques ou économiques, ceux-ci exploitent les discriminations et les frustrations sociales pour attiser les crises et engendrer des conflits aux conséquences souvent désastreuses.
Dans un pays comme la Mauritanie où la diversité socioculturelle représente à la fois une richesse et un défi, l’armée nationale constitue un rempart essentiel contre toute forme de sectarisme et de velléité déstabilisatrice. Face aux menaces que représentent les tensions identitaires et les flux migratoires incontrôlés, seule une armée omniprésente, disciplinée et résolument engagée dans la préservation de l’unité nationale peut garantir l’intégrité du territoire et la pérennité du vivre-ensemble. Son rôle dépasse largement la seule défense du pays contre les agressions extérieures ; il s’étend à la consolidation de la cohésion nationale à travers des actions de sécurisation, de développement et d’encadrement citoyen.
Ainsi, en assurant une présence vigilante et équilibrée, l’armée devient un acteur-clé de la stabilité nationale, conjuguant autorité et justice, fermeté et discernement. Loin d’être une simple démonstration de force, son engagement actif s’inscrit dans une vision stratégique de gouvernance où la défense des intérêts supérieurs de la Nation prime sur toute autre considération. La gouvernance civile des projets de développement est souvent entachée de clientélisme, de favoritisme et d’influences tribales ou ethniques, compromettant ainsi l’efficacité et la transparence des initiatives engagées. Ces dérives, qui affaiblissent l’État et ralentissent le développement, pourraient être considérablement réduites si l’armée était davantage impliquée dans la conduite et la supervision des projets d’envergure nationale.
Forte de sa discipline, de sa rigueur et de son sens du devoir, l’institution militaire offre un cadre plus structuré, moins perméable aux logiques partisanes et aux intérêts particuliers. Contrairement aux administrations civiles, où les considérations personnelles et communautaires peuvent prévaloir sur l’intérêt général, l’armée repose sur une hiérarchie stricte et une culture du mérite qui favorisent une gestion plus rationnelle et équitable des ressources. Ainsi, confier à l’armée certaines missions de développement stratégique permettrait non seulement d’assurer un pilotage plus efficace des projets mais aussi de renforcer la crédibilité de l’action publique. Dans un pays comme la Mauritanie, où les équilibres sociaux sont sensibles, une telle approche garantirait une meilleure impartialité dans l’exécution des programmes et limiterait les dérives qui entravent l’émergence d’un État fort et juste.
Mohamed Eleya





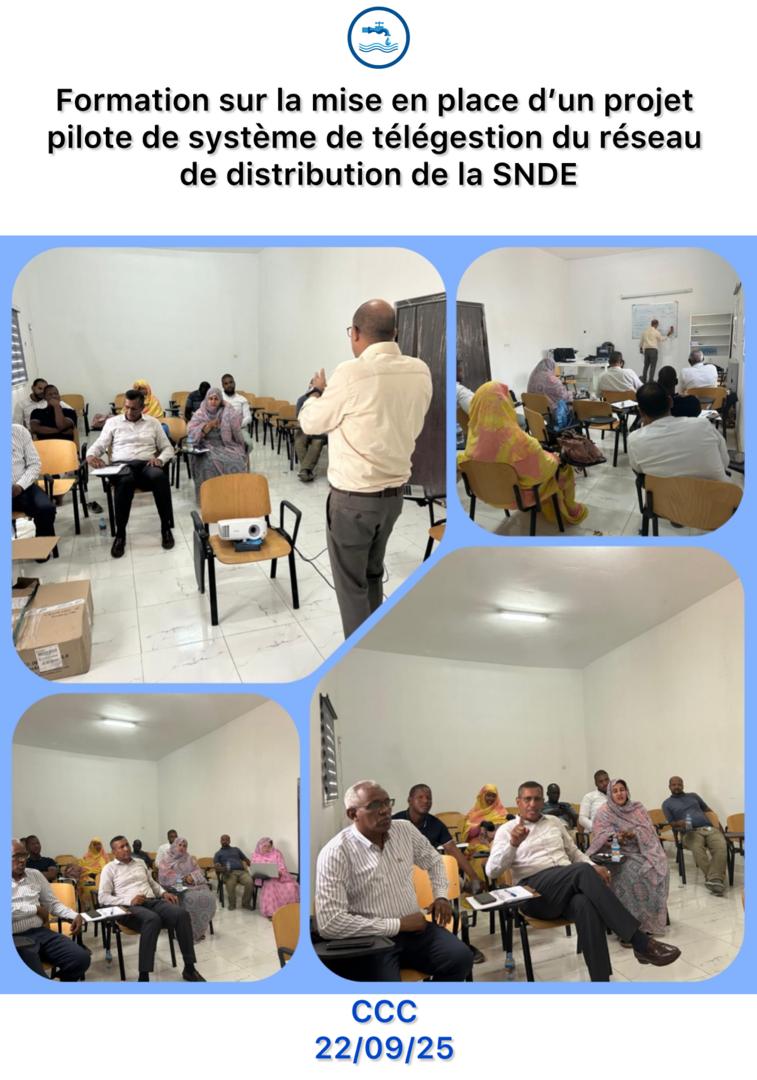
.gif)








.gif)