
L'autonomisation économique des femmes est un processus par lequel elles peuvent accroître leurs possibilités d'intervenir dans certains aspects de la vie sociale, en général, et dans les activités économiques, en particulier. Cette intervention sera de nature à les aider à passer d'une position économique fragile à une position qui les rende plus efficaces dans leur activité économique, afin qu'elles soient avant tout indépendantes. Quant à l'expérience mauritanienne à cet égard, cette autonomisation fait partie des choix et orientations irréversibles où notre pays s’est engagé grâce aux directives du président de la République qui ont accordé une attention particulière aux femmes, à commencer par leur présence essentielle dans le processus de réforme et leur contribution au chemin du développement. Fort de cette ambition, l’État s’est lancé dans un parcours de réformes sans précédent pour autonomiser les femmes et soutenir leur participation au développement durable, à travers une approche globale et intégrée.
De plus, l'autonomisation économique des femmes augmente si l'on tient compte du fait qu’elle n'affecte pas seulement le développement économique : elle s'étend au développement dans sa dimension globale, depuis l'environnement où la femme vit, à la hauteur de l'État auquel elle appartient, d'autant plus que la question de l'égalité des sexes n'est plus seulement un droit fondamental ou un luxe intellectuel, mais est devenue une nécessité, ce qui explique l'intérêt que les questions d'autonomisation des femmes ont reçu auprès de divers acteurs politiques, quelles que soient leurs positions partisanes et tendances idéologiques.
Notre pays a reconnu très tôt les droits des femmes en matière de promotion et de travail, depuis notre première Constitution en 1960 et leur a garanti l'exercice de leur droit de vote et de candidature aux élections législatives, même si la pratique a prouvé que ce droit était en fait réduit au droit de vote. Avec l'arrivée au pouvoir du président de la République et en raison du climat d'ouverture démocratique, la Mauritanie a adopté le mode de scrutin de liste dans le but d'accroître la représentation des femmes au sein des institutions constitutionnelles élues, et a adopté le « quota » en attribuant un tiers des sièges aux femmes dans le cadre de la liste nationale ; on a beaucoup parlé,
depuis, de cette l'autonomisation politique pratique et l'appel à la consolider et à la renforcer est resté fortement présent dans les discours des organisations politiques.
Le militant des droits de l'Homme appelle, quant à lui, au renforcement des droits de la moitié silencieuse de la société car celle-ci est moins chanceuse en matière d'éligibilité électorale, en plus de la transformation observée dans son statut et son rôle dans la famille où se développe un modèle qui s'éloigne progressivement du système patriarcal, tandis que la vitalité de la Société civile qui l'accompagne voit émerger de nombreuses associations concernées par les questions féminines.
Encadrée par les directives du président de la République, cette évolution s'accompagne d'un désir et d'une ambition de même ampleur, avec la même détermination et volonté d'autonomiser les femmes sur le plan économique. Cela a abouti à l’adoption d’un ensemble d’initiatives et de mesures, tantôt en forme de politiques publiques, tantôt sous forme de programmes et politiques sectoriels, dont le but ultime est d’améliorer l’activité et le rôle économique des femmes. Afin d’alimenter ce sujet, nous allons maintenant l’aborder selon deux axes.
,
Premièrement : gains = réalisations
Le modèle initial de développement avait identifié, parmi ses choix stratégiques, l’autonomisation des femmes avec indépendance et garantie de l’égalité des sexes. Sa plus récente version cherche à accroître la participation des femmes dans les domaines économique, politique et social. Les indicateurs de résultats de ce nouveau modèle ont identifié une nette augmentation du pourcentage de femmes actives. Fixé à 22% dans les dernières statistiques de 2019, 50% constitue l’objectif stratégique pour 2035, dans le but de développer l'économie nationale et de la transformer en une économie caractérisée par la multiplicité des activités et la compétitivité, en intégrant la population active dans le marché du travail, en particulier les femmes, en supprimant les barrières qui limitent leur participation aux activités économiques, en renforçant leur protection sociale et en développant des services et infrastructures qui leur permettent de participer.
Il s’agit par ailleurs d’assurer l'égalité des salaires et un accès équitable aux opportunités d'emploi dans le secteur public, en prendre des mesures concrètes pour atteindre des quotas de participation aux conseils d'administration des entreprises et aux organisations syndicales, tout en accordant des incitations fiscales au bénéfice des employeurs qui respectent le principe de parité entre les sexes.
Mesures inscrites au programme gouvernemental
Fort de son engagement à élever le pourcentage d'activité des femmes à 50% au lieu des 30% actuels, le gouvernement a lancé un ensemble de programmes et politiques sectoriels, avec notamment un partenariat entre l'autorité en charge de la solidarité et de la famille et les entités territoriales, avec l’objectif de renforcer l’inclusion économique des femmes et de les accompagner dans leurs projets individuels ou collectifs. Il vise surtout les femmes en situation difficile ou de vulnérabilité, en leur offrant des opportunités accrues d’emploi ; la promotion de l’entrepreneuriat et de la culture entrepreneuriale ; le renforcement de leurs capacités de gestion et de marketing dans la gestion de projets ; l’amélioration de leurs expériences et de leurs compétences dans le domaine de l'entrepreneuriat.
Dans le même contexte, ont été adoptés le cadre stratégique pour l'égalité et la parité à l'horizon 2030, ainsi que le troisième plan gouvernemental pour l'égalité 2023-2026, que le gouvernement a élaboré dans le cadre d'une approche participative avec toutes les composantes de la société autour de trois axes : autonomisation et leadership ; protection et bien-être ; droits et valeurs. Le programme évoqué ci-dessus vise à prendre des mesures pour renforcer les capacités des femmes dans le domaine de la gestion d'entreprise et du marketing électronique, encourager les organisations professionnelles féminines agricoles, en facilitant notamment l’enregistrement de coopératives à telle enseigne, et multiplier les formations qualifiantes. Un Comité national pour l'égalité et la promotion des droits des femmes a été également fondé. Ses missions consistent notamment à proposer des mesures nécessaires à l'autonomisation des femmes dans les domaines économique et politique, en particulier celles visant à augmenter leur taux d'activité en ces domaines.
Mesures juridiques et législatives
Pour faire les choix les plus audacieux en faveur de l'autonomisation économique des femmes, de nombreuses mesures juridiques parallèles ont été prises dans le but de perpétuer la volonté d'encourager la présence effective des femmes aux postes de décision économique. Quant au niveau de propriété de terres par les femmes rurales, notre pays a déployé des efforts exceptionnels pour les autonomiser, faisant en sorte qu'elles bénéficient, sur un pied d'égalité et sans discrimination, de tout ce qui relève de la propriété des groupes dynastiques.
Cheikh Ahmed ould Mohamed
Ingénieur
Chef du service « Études et développement »
Établissement portuaire de la Baie du repos (Nouadhibou)





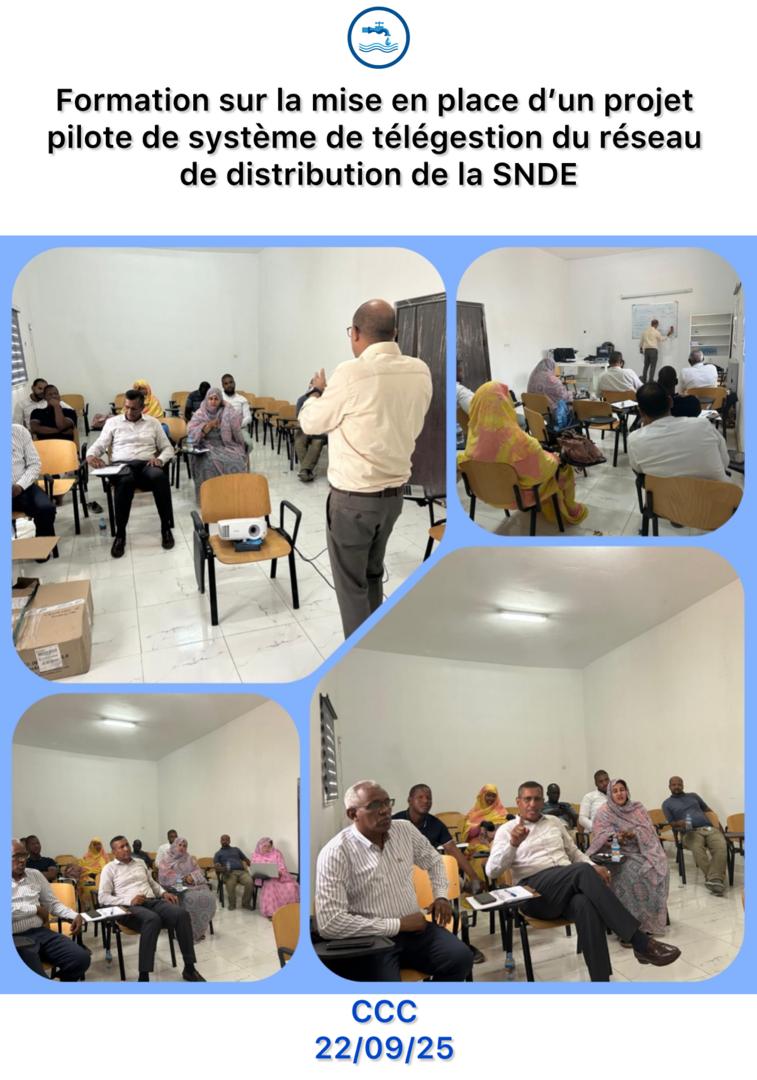
.gif)








.gif)