
Le présent dossier date de 2008. Il n’est pas, pour autant, vraiment dépassé par les évènements. En matière de formations techniques et professionnelles, où les investissements sont souvent coûteux et ne portent, généralement, leurs fruits qu'à échéance lointaine – de l'ordre, disons, de la décennie – il est nécessaire de donner de l'ampleur au regard, sans pourtant négliger de plus immédiates contingences. L'exercice n'est pas sans intérêt. Nous invitant à relier sans cesse le proche et le lointain, il nous accoutume à la plus saine des attitudes mentales, unifiant notre perception des réalités : condition probable des meilleures politiques... Mais c’est quoi, le proche et le lointain ? Pour entrevoir le présent, il ne suffit, bien évidemment pas, de se projeter dans l’avenir : il faut lire, avec lucidité, le passé et son legs. Tentons, en ce premier article, un survol de cet héritage et des probables orientations qu’il suscite…
Ouvrir un débat sur les formations techniques et professionnelles en Mauritanie, c’est, d’emblée, mettre à jour le caractère révolutionnaire, voire absolument inédit, de la pensée et de l’acte techniques dans l’univers mauritanien. Alors qu’une vraie tradition de l’écrit, d’essence religieuse, situait l’esprit des khaymas au niveau des plus grandes universités musulmanes, le rapport à l’objet – sa conception, son industrie, son usage – demeurait à l’étage des cultures les plus primitives. Revenons cent ans en arrière. Combien d’objets, alors, dans le quotidien des tentes, dans toute une vie d’homme au désert ? Une vingtaine, tout au plus ; à peine plus chez le forgeron, dont les outils rudimentaires révélaient, cependant, un art certain de la main, un sens inné de la débrouille, qui fleurissent, tout « naturellement » aujourd’hui, dans les productions, certes très variablement durables, de l’artisanat tieb-tieb, menuiseries à angle plus ou moins droits et rafistoles automobiles de pure mécanique-fiction.
C’est en milliers, désormais, que les objets peuplent notre univers, notamment dans les villes. Conçus et manufacturés, dans leur quasi-totalité, sous d’autres cieux, d’autres cultures, ils occupent notre espace, notre temps et nos soucis, plus fréquemment qu’on ne le croit. C’est avec eux que nos enfants construisent leurs schémas de pensée, échafaudent leurs féeries imaginaires, à mille milles des images de nos pères. La révolution est profonde et laboure un champ vierge ; au hasard, normalement ; dans un désordre indescriptible ; parfois joyeux, mais de moins en moins, comme en témoignent les altercations croissantes aux carrefours de notre capitale. Il va nous falloir, on s’en rend bien compte, ordonner ces « étrangetés » et notre relation à eux, sous peine d’en devenir, à brève échéance, les esclaves plus ou moins inconscients.
Esprit quadrillé
Dans les pays dits « développés », riches – ou lourds, comme on voudra l’entendre – de siècles d’industries variées, la formation technique est induite dès les premières années de la vie, par l’intégration de comportements socioculturels ancrés depuis des générations. L’esprit est comme quadrillé, millimétré même, par des contraintes spatiotemporelles rigoureuses, dictées par l’objet lui-même – murs, fenêtres, portes des maisons ; mobilier, vaisselle, jouets, outils, etc. – ou par les conditions de sa production, de son commerce et de son usage – division du travail et des savoirs, fractionnement de l’emploi du temps, urbanisme, consommation, pollution, etc. Sans discuter, ici, ni des tares d’un tel quadrillage, ni de l’impact, décisif, de l’intimité du foyer familial dans sa genèse, on remarquera l’importance de l’objet, de la manipulation des matières et des formes dans l’univers occidental des jardins d’enfants et autres classes maternelles, où l’expérimentation directe, l’éducation par tâtonnement empirique, au ras des sensations et de la confrontation progressivement ordonnée des « points de vue » – du plus littéral au plus figuré sens de l’expression – occupent une place considérable, dans la construction de l’esprit.
La perception de cette approche pédagogique, hors un cercle restreint d’initiés, reste assez floue, dans l’esprit mauritanien où l’on confond, banalement, ludique et futile. On entrevoit, à peine, que la concrétion de la logique humaine dans l’espace et le temps – mouvement même de l’esprit technique – relève, en tout premier lieu, d’une acuité sensorielle la plus diversifiée possible, fluidifiée par des systèmes d’échanges ouverts, peu contraignants, où les notions d’échec et de réussite sont aisément remises en cause. C’est en tombant qu’on apprend à marcher, en balbutiant qu’on en vient à parler, en forgeant qu’on devient forgeron. Le pédagogue averti use de ce constat universel, pour favoriser l’expression naturelle des séquences logiques, entre l’enfant et son environnement, en lui fournissant des matériaux et des situations palpables, des temps de libres tâtonnements expérimentaux, puis des outils adaptés ; enfin – mais pas forcément – des méthodes éprouvées d’investigation. Dans quelles mesure et fréquence, cependant, le pédagogue mauritanien est-il capable de lire, lui-même, les séquences logiques exprimées par l’enfant ; d’en exploiter le potentiel didactique ? Confronté, le plus souvent, à sa propre indigence technique, il est, en outre, contraint par une misère d’équipements, tant en matériaux qu’en matériel. Ainsi se perpétuent des lacunes culturelles, désormais vécues, dans la modernité mondialisante, comme autant de ruptures socio-économiques.
La nature ayant horreur du vide, c’est toute la société, à tous les niveaux, qui est affectée par cette carence. Du point de vue macro-économique, c’est le surdéveloppement du secteur tertiaire, en particulier des activités commerciales. De l’ordre de 40 % en 1990, sa part dans le P.I.B. approchait les 45 % en 2000 et pourrait atteindre les 50 % dans la seconde décennie du XXIème siècle. Mais l’importance d’un commerce extérieur – plus de 70 % du P.I.B. en 2000 – largement dominé par l’exportation de seulement deux produits primaires (minerai de fer et ressources halieutiques) et l’importation d’hydrocarbures raffinés rend l’économie nationale hypersensible aux aléas du marché mondial et des tempêtes monétaires internationales. Réflexe sécuritaire universel, particulièrement prononcé en terres musulmanes où l’épargne n’a guère bonne presse (en Mauritanie, moins de 8 % du P.I.B. au tournant du millénaire), on se réfugie, alors, dans l’immobilier : c’est un des rares secteurs où une élévation sensible du niveau technique est notable dans la dernière décennie.
D’incompétences en faux-fuyants
Si les trois millions et demi de personnes qui constituent la nation mauritanienne n’avaient à gérer qu’un territoire minimal, à l’instar de certaines cités souveraines spécialisées dans l’activité commerciale, de telles orientations pourraient s’avérer rentables. Appelées à valoriser un espace de plus d’un million de kilomètres carrés, elles apparaissent, pour le moins, dérisoires et le gâchis d’un tel potentiel ne cesse d’intriguer. L’exemple suivant – qui suggère, au passage, de certes plus obscures adaptations au vide technique de l’esprit mauritanien – semble assez parlant. Cumulée, depuis cinquante ans, l’aide internationale a dépassé, dans le seul domaine de l’agriculture, les deux cents milliards d’ouguiyas. Rapportés à la superficie cultivable, c’est quelque quarante millions d’ouguiyas au km² et, même à considérer très largement l’espace agricole – disons 10 % du territoire national – cela reste encore un investissement d’au moins deux millions d’ouguiyas au km² dont on cherche, désespérément aujourd’hui, la moindre plus-value (lire, à ce sujet, la très pertinente revue « Etat des lieux et perspectives à court et moyen terme » exécutée par le défunt MDR en Février 2007).
D’incompétences en faux-fuyants et de faux-fuyants en détournements, on en vient ainsi à réduire le champ de la vie active et l’exode rural en est la plus visible manifestation. En 1930, on comptait à peine 15 000 citadins pour une population totale de 600 000 personnes – soit 1 citadin pour 38 ruraux. A l’horizon 2030, on table sur une population globale de six millions de personnes, dont quatre millions six cent mille urbains – 10 citadins pour 3 ruraux. On méditera ces chiffres à l’aune du suivant, qui situe un aspect non moins préoccupant du rétrécissement en cours : les importations de céréales ont été multipliées par seize, entre 1961 et 1998. Quoique la Mauritanie, à cet égard, s’en sorte notablement mieux que nombre pays de la sous-région – ces mêmes importations ont été multipliées, au cours de la même période, par 27 au Togo et par 250 au Niger – la question des productivités du sol, du travail et du capital, devient essentielle. Elle ne se limite, à l’évidence, pas au seul secteur agricole. Le ratio global export/import, qui se situait à 0,76 en 2001, est tombé, en moins de 5 ans, à 0,44. Au-delà de la conjoncture pétrolière, c’est l’indigence des capacités industrielles, faute d’investissements en outils productifs et de niveau technique adéquat, qui est, ici, pointée du doigt. Il y aurait beaucoup à dire sur le recours systématisé à des investissements étrangers, si prisé, par exemple, chez notre voisin sénégalais dont le petit peuple découvre, très concrètement désormais, le caractère néocolonial de telles requêtes. Mais ce serait trop déborder de notre sujet, bien qu’un des moyens de minimiser l’impact négatif des investissements exogènes soit, justement, de les conditionner à une implication effective dans la formation technique et professionnelle nationale.
Il est probablement plus intéressant d’aller, directement, à la question alternative qui fâchera, peut-être, les autruches, mais certes pas les patriotes. Dans quelle mesure, dans quels délais, les investisseurs nationaux se décideront-ils à sortir la tête du sable, à assumer leurs responsabilités nationales, en prenant à bras-le-corps, et leur propre inculture technique, et celle de leurs employés, réels ou potentiels ? L’interrogation, on l’a vu tout au long de ce premier article, est bien d’ordre culturel avant de s’imposer en termes économiques. Le temps des têtes sans mains et des mains sans tête est révolu. Lorsqu’un Aïdara retroussera ses manches et en remontrera à ses collaborateurs et ouvriers, sur le terrain et l’outil à la main, démontrant, sans discours, que la noblesse, la qualité d’être au monde, ne méprise aucune activité – mieux : se plaît en toute – pour réaliser sa mission, un pas, décisif, aura été accompli. La démarche n’exclue pas une réflexion active quant aux équilibres à préserver, bien au contraire : en situant les meilleurs au cœur de l’action, on la dirige au mieux… (à suivre)



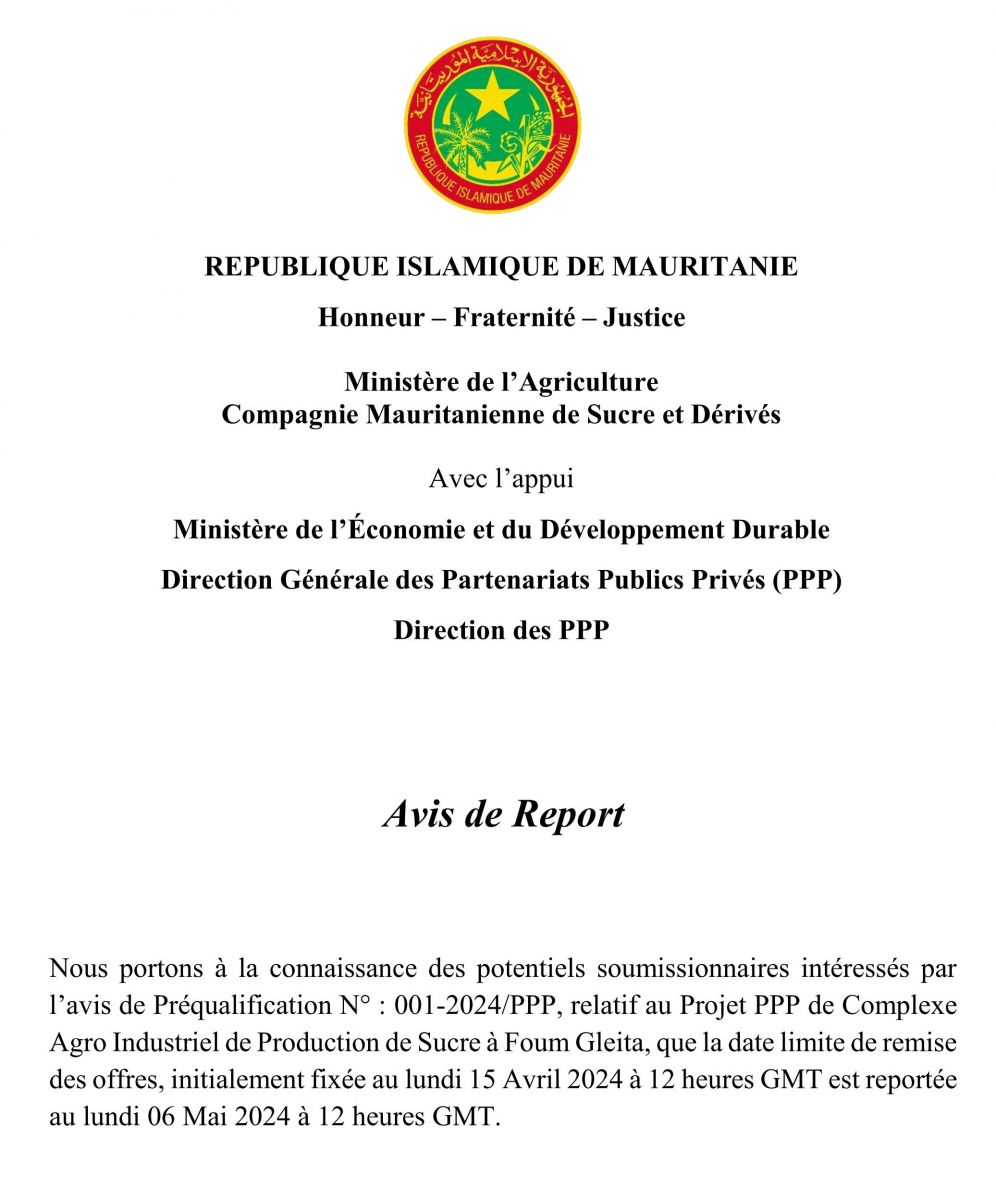









.gif)