
Depuis quelques temps, l’espace politique mauritanien est traversé par la question lancinante de la modification de la constitution pour permettre à l’actuel président de la République de briguer un troisième mandat présidentiel.
L’intéressé s’est toujours prononcé expressément pour un respect des dispositions de la constitution et donc pour le respect de la règle de la limitation des mandats présidentiels, mais une des propositions phare de ses partisans au dialogue national en cours consiste précisément à faire sauter ce verrou.
Cela nous amène naturellement à nous poser la question : à quoi sert la constitution ?
Déjà, il y a quelques mois, quelques-uns de ses serviteurs les plus zélés avaient soutenu que le président avait besoin de plus de temps pour « poursuivre et parfaire l’œuvre grandiose et salvatrice qu’il a commencée ».
Cette justification, grotesque pour toute personne douée de jugement, ne trouve évidemment aucune justification, ni dans la constitution elle-même, ni en droit en général. Le président n’est pas élu pour « parachever » une œuvre, il est élu pour un programme limité à cinq ans, renouvelable une seule fois. S’il ne parvient pas à accomplir son ‘‘œuvre’’ dans ce laps de temps, cela doit être normalement retenu contre lui comme une preuve d’incompétence, au mieux comme une erreur de jugement, en aucun cas comme un argument pour rempiler avec un énième mandat, avec à la clé une modification constitutionnelle.
Dictature contre liberté
En réalité, sous nos latitudes, cela est à peine surprenant. Depuis son indépendance, notre pays a toujours été tiraillé entre deux principes : la Force et le Droit. La dictature contre la liberté, la superstition contre le savoir, le conservatisme contre le progrès.
Dans toutes les contrées, les forces de progrès gagnent du terrain ; chez nous, on en est encore à se demander laquelle de ces puissances finira par l’emporter.
Le principe de droit suppose une exigence cardinale : que les autorités du pays, à tous les niveaux, et particulièrement à mesure que l’on s’élève dans le niveau de responsabilité, acceptent de soumettre leurs décisions aux règles de droit. C’est ce qu’on appelle communément aujourd’hui l’Etat de droit.
C’est l’Etat qui créé les règles juridiques, dans un souci d’organisation, et il lui appartient, au premier chef, de s’y soumettre soi-même. Evidemment, quand on envisage que l’Etat soit soumis au droit, il s’en suit que les personnes et institutions qui l’incarnent le sont tout autant. L’Etat, en tant qu’entité abstraite, en tant que fiction juridique, est de toutes les façons soumis au droit. Il sécrète lui-même les règles qui organisent et encadrent son activité, et qui aussi, lorsque cela est nécessaire, limitent son pouvoir de décision et d’action.
Un éminent juriste parle d’ailleurs à cet égard de « miracle », que l’Etat qui créé le droit acceptât de s’y soumettre lui-même, sans aucune contrainte extérieure. Le droit étant en définitive une série de limitations, il est en effet surprenant que celui qui en est l’auteur et le créateur accepte de s’y soumettre. Mais la notion même d’Etat l’exige, depuis l’origine, et avec de plus en plus d’acuité et d’effectivité à mesure que l’Etat se démocratise. Il en est ainsi partout.
En Mauritanie, où la notion d’institution a encore du mal à prendre pied, c’est la personne qui est au pouvoir qui attire toutes les attentions. Elle attire, subjugue et fait peur en même temps. Le président de la République n’est pas le « chef de l’Etat », c’est le chef de la « meute ».
J’ai encore en mémoire les propos passionnés d’un de mes amis, partisan enthousiaste de Ould Abdel Aziz, lors de la campagne présidentielle de 2009. Malgré sa formation d’universitaire (je crois même qu’il est mathématicien, ce qui implique en principe une certaine faculté d’abstraction) et en dépit des arguments et contre-arguments que les uns et les autres échangeaient méthodiquement pour évaluer les chances de chaque candidat, notre ami nous ressassait inlassablement, à la limite de l’hystérie, « c’est Aziz qui va passer au premier tour, et de loin, le « type » est né pour exercer le pouvoir, il va les croquer, le pouvoir c’est une affaire de tripes ».
Convenez avec moi que les tripes sont assez éloignées de l’abstraction. Mon ami était sorti, sans même s’en apercevoir, de son parcours universitaire et intellectuel, pour renouer de façon presque subliminale avec des archétypes d’un autre âge.
J’ai aussi en mémoire, quelques années auparavant, la sortie d’un respectable « démocrate » qui jouait un certain rôle en 2003 dans le staff de campagne de Ould Taya, « notre pays n’a pas forcément besoin d’alternance, disait-il, d’ailleurs le concept d’alternance est étranger à notre culture arabe et islamique ». C’est que le principe de force nous vient du plus profond de nous-mêmes : de notre vieille histoire, arabe et africaine.
Etat de (non) droit
L’Etat de droit, quant à lui, nous vient des meilleurs apports extérieurs, des influences européennes postcoloniales. L’un irrigue nos veines, l’autre nos esprits. Nous sommes partagés entre l’attrait irrationnel pour l’un et le choix conscient de l’autre. Il en résulte une inadéquation permanente entre le contenu de la règle de droit et son application concrète qui se retrouve en Mauritanie dans des pans entiers de la matière juridique, son illustration la plus visible étant sans aucun doute offerte par la législation constitutionnelle, faite des règles constitutionnelles les plus élaborées, sans cesse détournées et rattrapées par la pratique (coups d’Etats, Chartes constitutionnelles, régimes « transitoires », révisions constitutionnelles, etc.).
Le débat qui prend racine aujourd’hui trouve son ancrage profond dans cette oscillation entre le droit et la force. A cet égard, les élites ont un rôle crucial à jouer. De leur position et de leur détermination dépend notre avenir : soit l’affermissement de l’Etat de droit, seule garantie de démocratie, de justice et de progrès, soit la consécration d’une république bananière avec ses iniquités, ses dérives et tous ses dangers potentiels.
Sous cet angle, la limitation des mandats garantit le renforcement de l’institution présidentielle où nous nous retrouvons tous, l’absence de limitation ne renforce que la personne au pouvoir au détriment de l’intérêt général.
La règle de la limitation des mandats présidentiels a été inaugurée par le premier président des Etats Unis d’Amérique, et père de l’indépendance américaine, George Washington, il y a déjà plus de deux siècles. Adulé par tout un pays, George Washington aurait pu rester au pouvoir aussi longtemps qu'il l’aurait souhaité, et ce d’autant qu’aucune limite n’était inscrite alors dans la constitution américaine. Mais en 1797, après deux mandats, il a fermement, et contre l’avis de ses amis, décidé de rentrer dans ses terres de Virginie, pour « cultiver son jardin ».
Cette règle non écrite a été respectée par ses successeurs, qui voulaient marquer leur différence (et leur désapprobation) avec le régime monarchique britannique. De tous les présidents américains, seul F. D. Roosevelt a exercé un troisième, puis un quatrième mandat. Diminué et malade à la fin de son règne, il a été la preuve vivante du danger de la longévité au pouvoir et les américains ont vite fait d’amender leur constitution pour transcrire cette règle jusque-là non écrite dans le corpus constitutionnel limitant ainsi les mandats présidentiels à deux. L’exemple des Etats-Unis fut suivi par la suite par la quasi-totalité des Etats.
Dans l’absolu, certes, le débat reste ouvert, on peut être pour ou contre la limitation des mandats, mais il convient de ne pas oublier dans quelles conditions cette règle a été décidée en Mauritanie par l’ensemble de la classe politique dans un consensus général. On était au lendemain du coup d’Etat qui a renversé le régime de Ould Taya et tout le monde s’accordait à l’époque sur la nuisance extrême pour le pays qu’ont représenté les réélections de ce dernier (en 1997 et 2003) et la longévité sans fin que lui garantissaient ces réélections.
Cette réforme de la constitution était légitime pour au moins deux raisons : d’abord, elle était intervenue quinze ans après l’adoption de la constitution de 1991, un délai somme toute raisonnable pour faire un bilan. Ensuite, elle a permis de corriger le principe de non limitation des mandats qui constituait une malformation congénitale de la constitution de 1991 et ce sur la base d’un consensus national (y compris de la part des militaires toujours au pouvoir aujourd’hui).
Il est cependant à déplorer que cette réforme constitutionnelle fut suivie par une autre en 2012 et qu’on en prépare encore en 2016.
Si la constitution n’est pas un « Coran sacré » comme certains le martèlent religieusement aujourd’hui, si elle n’est que l’émanation de la volonté populaire qui peut changer (deux postulats qui sont justes par eux-mêmes), cela ne veut pas dire que la modification de la constitution soit chose banale et routinière (déduction fausse).
La constitution a beau n’être qu’un texte de loi, cela n’en fait pas un simple décret à modifier tous les quatre ans ! N’oublions pas que la constitution est, comme chacun le sait, « la loi fondamentale ». Faut-il revisiter les fondements aussi souvent ?
A la vérité, les modifications constitutionnelles interviennent rarement dans la vie des nations. Elles correspondent en général, soit à des ajustements techniques dans la sphère constitutionnelle (par exemple, la modification de la durée du mandat présidentiel), soit à des orientations politiques nouvelles majeures (par exemple, la limitation du nombre des mandats présidentiels). Dans ce dernier cas, la modification constitutionnelle est la consécration au plus haut niveau de la loi d’un changement profond au sein de la société, en général dans le sens du mûrissement de la démocratie. C’est ce qui s’est passé en Mauritanie en 2006.
En effet, il est partout constaté que les modifications de la constitution traduisent dans un langage formel et juridique l’aboutissement des idées, des valeurs et des principes qui ont traversé la société à une certaine époque, d’où l’idée d’un perfectionnement continu dans le sens de la justice, de la démocratie et de l’Etat de droit.
Un défi inédit
Car au fond, c'est bien la question de l'Etat de droit qui est au cœur du débat.
Pour les élites mauritaniennes, la question qui se pose est simple: Faut-il défendre le renforcement de l'Etat de droit ou bien faudrait-il au contraire, pour des considérations strictement domestiques et alimentaires, accepter de faire de son pays la chose d'une personne?
Les élites doivent résister et combattre la vieille antienne qu’on sort aujourd’hui, à savoir que la constitution n'est rien d'autre que l'expression de la volonté populaire, figée à un moment donné dans un texte, le peuple, souverain, pouvant la modifier dans toutes ses dispositions et à tout moment.
C'est une antienne maintes fois ressassée en Afrique. Le mot clé ici est le "peuple". Comme le disait Thomas Mann, lorsqu'on veut entraîner les foules à un acte réactionnaire et nuisible, il suffit de les apostropher en les appelant "peuple".
Le peuple ici revêt un anachronisme dangereux, comme le "peuple" qui a porté Hitler au pouvoir. Il draine un sens archaïque. On s'y réfère et on le glorifie lorsqu'on veut tordre le cou au droit et à la morale.
Par sa profondeur et sa portée, cette question dépasse les clivages politiques classiques. Ce n'est pas parce qu'on appartient à la majorité actuelle que l'on doit nécessairement demander que les mandats présidentiels ne soient plus limités. Il ne s'agit même pas d'une question de personne; on peut aimer Ould Abdel Aziz ou pas, la question n'est pas là, il s'agit d'une question de principe, pour notre pays, pour nous-mêmes, pour nos enfants et les générations à venir.
Cette question se présente aujourd’hui comme un défi inédit pour nos juristes.
Il ne fait aucun doute pour moi qu'aucun des juristes mauritaniens qui constituent des références véritables (je pense en particulier aux professeurs Bouboutt, Mohamed Saleh, Gourmo Lo, Lebatt, et tant d'autres brillants juristes) n'acceptera de cautionner pareille hérésie.
Au-delà de la sphère des juristes, ce sont les élites de façon générale qui sont interpellées (universitaires, cadres, enseignants, professions libérales, entrepreneurs etc.) ; sur leurs épaules repose l’énorme et permanente responsabilité de défendre une Mauritanie démocratique, où règne la justice, le respect du droit, la force des institutions, garanties indispensables à tout développement et à toute stabilité.
Nous sommes aujourd'hui au premier grand tournant de notre jeune régime constitutionnel démocratique : ou bien on le laisse se dérouler normalement avec un changement au pouvoir en 2019 (qui peut, soit dit en passant, être une alternance ou bien la poursuite de l'actuelle majorité avec une nouvelle personne à la présidence), et alors notre train continuera son chemin, soit nous faisons sauter le verrou constitutionnel et alors nous nous engagerons, comme disent les aiguilleurs, sur une voie désaffectée, semée d’embûches où le déraillement est plus que certain.
Devant ce choix, les élites mauritaniennes sont aujourd’hui face à leurs responsabilités.
Demain, il sera trop tard. Demain nous serons jugés par l’histoire et par nos enfants sur les choix que nous aurons faits aujourd’hui.
Maître Elyezid OULD EL YEZID



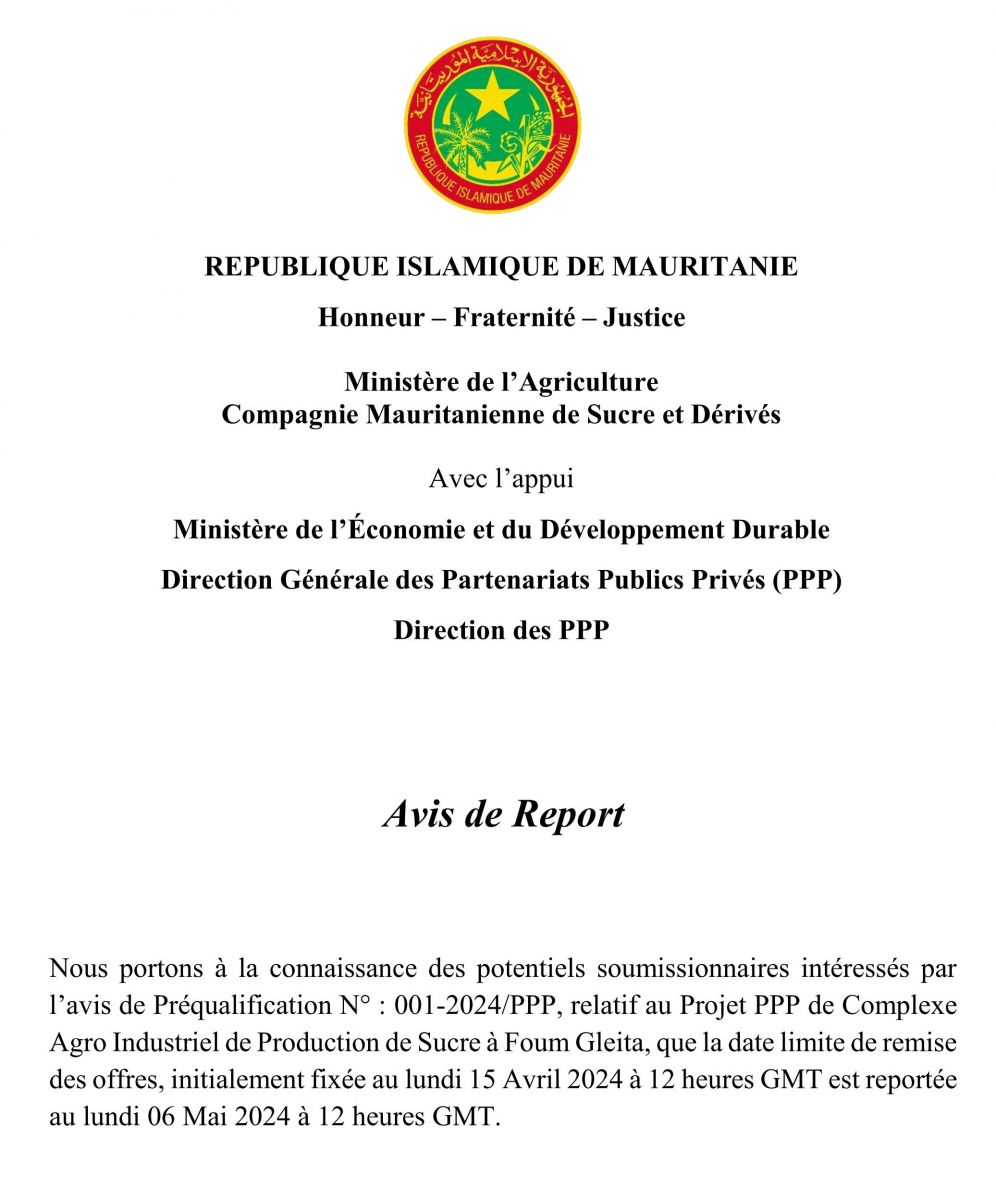









.gif)